
L’agence Nantes Atlantique de CDC Habitat organise, depuis le printemps, des sessions de formation autour de la santé mentale à destination de ses locataires et de ses collaborateurs. Un format pédagogique qui rencontre un franc succès et que CDC Habitat Grand Ouest envisage de déployer sur l’ensemble du territoire.
Entretien avec Laura Aubert, responsable de secteur à l’agence Nantes Atlantique de CDC Habitat.

Vous êtes à l’origine de ce projet de formation autour de la santé mentale : pourquoi avoir choisi de vous saisir de cette thématique ?
Laura Aubert : La santé mentale est un sujet face auquel nous sommes souvent démunis, que ce soit lorsque l’on y est confronté à titre personnel ou à titre professionnel. Je suis référente « santé mentale » au sein de l’agence Nantes Atlantique, c’est un sujet qui me tient à cœur. Je me suis souvent dit que ce serait bien de pouvoir permettre aux personnes de mieux cerner cette question complexe. Alors quand l’appel à projet L’ISA (L’innovation sociale en action) a été lancé l’an dernier, invitant les collaborateurs de CDC Habitat à proposer des actions autour de plusieurs thématiques dont celle-ci, j’ai imaginé la possibilité de porter une formation dédiée en lien avec des spécialistes locaux.
En quoi consiste cette formation ?
LA : Il s’agit d’un format porté par PSSM, Premiers Secours Santé Mentale, une association qui s’attache à lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques. L’association a adapté un programme reconnu à l’international, le MHFA (Mental Health First Aid), qui vise à proposer à tous les citoyens une formation généraliste de sensibilisation et d’assistance en santé mentale. Il s’agit d’avoir une vue d’ensemble sur les questions de santé mentale et surtout de démystifier le sujet et de lutter contre les idées reçues. C’est une thématique très vaste, qui couvre à la fois la schizophrénie, la dépression, les addictions, le stress post-traumatique et le suicide. Depuis la crise sanitaire COVID, les situations se multiplient. Qu’il s’agisse des équipes de nos agences, de nos gardiens sur le terrain ou de nos locataires, personne ne sait vraiment comment réagir face à quelqu’un qui présente des troubles psychiques.
Comment se passe une session ?
LA : Chaque session se déroule sur 2 journées, animée par une psychologue de Nantes recommandée par l’association, Solène Evrard. Il y a une présentation globale de ce que couvre la santé mentale, et surtout beaucoup de mises en situation autour de trois grands axes : identifier, aider, passer le relais. Comment réagir face à tel comportement ? Comment reconnaître les signes avant-coureurs, identifier tel ou tel symptôme ? Comment rentrer en contact avec la personne ? Qui contacter en cas d’urgence ? Le mot d’ordre est de dire aux participants qu’il faut savoir être à l’écoute. Evoquer ces sujets fait écho au vécu de chacun, ça peut être très intense et touchant, ça remue forcément des choses chez les personnes formées.
Quels sont les retours que vous avez eu suite aux premières sessions ?
LA : Les 4 sessions proposées ont été complètes très rapidement. On voit bien que c’est un sujet qui interroge. Il est important de donner les clefs aux personnes, notamment à nos équipes, de les rassurer, de les déculpabiliser aussi dans certains cas. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, d’autres non – nous ne sommes pas médecins, juste des citoyens, des voisins, des professionnels du logement… Globalement, les participants se sont sentis renforcés à l’issue de cette formation même si certains craignent d’être confrontés à ces situations et de ne pas savoir les gérer. Et c’est bien naturel.
C’est pour cela que vous souhaitiez associer les collaborateurs lors de ces sessions ?
LA : Tout à fait. S’il y a bien un sujet sur lequel nous sommes tous sur un même pied d’égalité, c’est celui-là. D’ailleurs, CDC Habitat Grand Ouest réfléchit à déployer le dispositif plus largement sur le territoire et à intégrer le cursus à notre catalogue interne de formation. Plus les personnes seront sensibilisées aux questions de santé mentale, plus nous pourrons accompagner les personnes qui en souffrent.
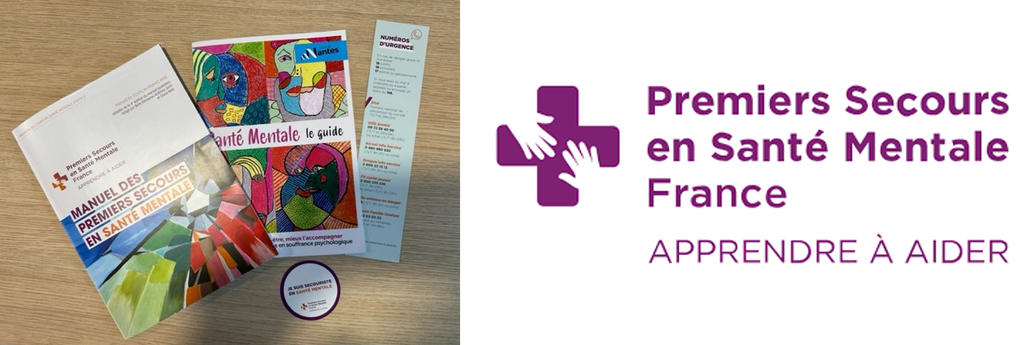


Ambdilwahedou Soumaila, maire de Mamoudzou, explique l’importance de l’habitat dans l’équilibre social de son territoire et ses attentes fortes vis à vis de la SIM, premier bailleur de Mayotte.
Quelles sont les problématiques en termes d’habitat sur la commune et plus généralement sur l’île?
Selon les données du RGP Insee 2017, Mayotte comptait 63 130 résidences principales, dont 17 870 à Mamoudzou. Parmi celles-ci, la part des maisons en tôle (maison en tôle, bois, végétal ou terre) était de 39 % à l’échelle de l’île et de 47 % à Mamoudzou.
Actuellement, on observe une urbanisation illégale et spontanée à Mamoudzou, principalement due à l’extension des constructions de ces cases en tôle, ce qui contribue à la formation de bidonvilles sur de vastes zones du territoire communal. Sans compter que l’accès à l’eau courante (et aux réseaux en général) reste problématique dans ces logements.
Il existe donc un besoin pressant de logements, mais pas seulement sociaux. Et l’espace étant restreint sur l’île et le foncier disponible et aménagé se trouvant principalement en zone urbaine, où les infrastructures sont déjà en place, il est nécessaire de réinvestir ces zones et d’opter pour des constructions à haute densité.
Quelles sont vos attentes en termes de programmation ?
Traditionnellement, les quartiers à Mayotte sont mixtes et nous voulons maintenir cette mixité pour accueillir toutes les strates de la population. Ce n’est pas seulement une problématique liée au logement social : les premières enquêtes sociales menées dans la zone de la ZAC de Doujani ont montré un nombre limité, voire faible, de ménages éligibles au logement social. Il est donc crucial de répondre au fort besoin de logements en adoptant des approches qui prennent en compte les différentes catégories de logement, du locatif social au locatif intermédiaire, en passant par l’accession à la propriété.
A titre d’exemple, dans le cadre du NPNRU de Kaweni, nous travaillons à mettre en place tous type de logements : LLTSA, LLTS, LLS mais aussi intermédiaire et en accession.
La SIM a beaucoup œuvré par le passé pour favoriser l’accession à la propriété sur l’île…
Le concept de la « case SIM » a effectivement joué un rôle important à cet égard et a laissé une marque durable à Mayotte. Aujourd’hui, il est essentiel de revitaliser le marché de l’accession, en particulier pour les jeunes actifs. Cette approche vise à soutenir la création d’un parc immobilier diversifié.
Il faut néanmoins rester vigilant avec ce type de logement pour ne pas créer le bidonville de demain. La réflexion architecturale et la mixité de logement et de population sont certainement une des clefs de la réussite des futurs aménagements urbains.
Y a-t-il des usages particuliers à prendre en compte dans la conception des logements ?
Lors de la conception des logements, il est essentiel de prendre en compte certains usages particuliers afin de répondre aux besoins et d’améliorer la qualité de vie des résidents.
Tout d’abord, il est recommandé de prévoir des espaces extérieurs dans la conception des logements. Ces espaces permettent aux résidents de profiter de l’air frais, de se détendre et de se connecter avec la nature environnante. Ils peuvent prendre la forme de balcons, de terrasses, de jardins ou d’espaces verts communautaires.
Ces zones extérieures offrent un espace supplémentaire pour se reposer, se divertir et favorisent les interactions sociales entre les résidents. Elles peuvent être conçues à différentes échelles, allant des places au sein d’un ilot de logement aux espaces communs plus vastes. Elles peuvent être utilisés par les résidents pour organiser des activités, rencontrer leurs voisins ou célébrer des événements.
Par ailleurs, il convient de souligner l’importance de la « varangue » (véranda) dans l’architecture du logement mahorais, qu’il s’agisse de logements sociaux ou non. La varangue est une pièce à vivre à part entière, offrant un espace de vie supplémentaire et permettant de profiter du climat agréable de l’île. Il est crucial de la considérer comme une composante essentielle du logement et de lui accorder une attention particulière dans la conception architecturale. Cependant, il est nécessaire de noter que le calcul du financement du logement social peut actuellement limiter la possibilité de créer de grands espaces extérieurs. Il est donc important de reconnaitre la valeur de la varangue en tant que pièce à vivre et soutenir son intégration dans la conception des logements.
Quelles sont les attentes de la mairie vis-à-vis de la SIM ?
Dans le contexte mahorais et malgré le développement accéléré de l’urbanisation, la commune de Mamoudzou se caractérise par une organisation en villages qu’il est souhaitable de maintenir pour garantir un cadre d’aménagement et un certain équilibre social ; les évènements actuels sur l’insécurité ambiante plaident dans ce sens.
L’organisation en villages et le maintien d’une gestion à cette échelle a toujours servi de cadre d’action et de décision. De cette organisation villageoise découlait l’attribution des parcelles et des logements et donc la question du peuplement. Cette attribution s’est faite jusqu’à présent à l’échelle du village et principalement à destination des habitants du village.
Les zones d’extension sont limitées et inégalement réparties. Certains villages n’ont aucune possibilité physique d’extension. D’autre part, certaines zones d’extension ne sont envisageables qu’à très long terme.
Dans ces conditions, la commune doit définir et pouvoir afficher ses priorités en matière de politique de l’habitat et d’attribution de logement à partir des besoins de sa population. Dans les commissions d’attribution des logements, bien que représentée, la commune ne pèse pas réellement dans le choix des attributions car elle est rarement réservataire. L’enjeu pour la commune est de devenir réservataire de logements dans chaque commission pour pouvoir influer sur le choix des attributions et du peuplement dans les différents quartiers de la commune.
Il est clair que le mode d’attribution ne peut plus se limiter seulement au village où seront implantés les logements ; il nous semble néanmoins nécessaire que l’attribution des logements privilégie en priorité les habitants de la commune.
Par exemple, le village d’implantation pourrait instaurer une préférence d’attribution à hauteur de 50 % aux demandeurs du village, 20 % à 30 % des logements seraient donc proposés aux autres villages de la commune et les autres logements aux habitants d’autres communes. Sur cette base, la cohésion sera préservée et l’intégration des nouveaux arrivants facilitée.

CDC Habitat met en place un Plan Stratégique Climat visant à limiter l’impact et les consommations de son patrimoine et à tendre vers un mix énergétique moins dépendant des énergies fossiles. Une démarche qui s’inscrit dans la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici à 2100.
110 kWh d’énergie primaire et moins de 15 kg de CO2 par m2 et par an à l’horizon 2030 : c’est l’objectif que s’est fixé CDC Habitat afin d’aligner le plus tôt possible son patrimoine sur la trajectoire nationale visant à limiter la hausse des températures sur la planète à 1,5°C d’ici à 2100. Il faut dire que le premier bailleur de France a un rôle central à jouer sur le secteur de l’habitat avec un parc de près de 354 000 logements sociaux et 108 000 logements intermédiaires – et des performances actuelles de 134 kWhep/m2/an et 22 kCO2/m2/an à la fin 2022.
Si la marche peut sembler haute sur le papier, CDC Habitat a déjà réduit de plus de 40% ses consommations d’énergie primaire en l’espace de 15 ans, grâce à un plan stratégique énergétique déployé depuis 2008. Le Groupe a donc décidé de capitaliser sur l’expérience acquise pour accélérer la transition et entraîner dans son sillage un maximum d’acteurs, via un Plan Stratégique Climat élargi autour de trois axes stratégiques et de multiples leviers d’action.
Continuer à réduire les besoins et les consommations en énergie
La rénovation du patrimoine existant avec amélioration de la performance énergétique du bâti reste au cœur de l’action du Groupe. La démarche est déjà bien installée, avec un travail systématique sur chaque opération menée depuis 2008 (isolation thermique par l’extérieur, travail sur les combles ou les toits-terrasse, rénovation des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire…), et une volonté de cibler les patrimoines les plus énergivores. Une cartographie de l’ensemble des DPE du patrimoine a été réalisée afin de fixer les priorités d’intervention – toutes les étiquettes G et F, et une grande partie des étiquettes E, devant être traitées dans les 7 années qui viennent.
Au-delà de la rénovation de l’existant, le Groupe affiche la même exigence pour ses programmes neufs, avec notamment la volonté d’anticiper les obligations de la RE 2020 qui fixe différents « seuils carbone » à atteindre d’ici 2025, 2028 et 2031. Dès cette année, l’objectif est de viser au moins 25% des projets portés par CDC Habitat qui atteindront le « palier 2025 » de la RE 2020 et le Groupe souhaite aller encore plus loin dans les années qui suivent.
Accélérer la transition vers un mix énergétique moins carboné
Avec près de 60% de son patrimoine chauffé au gaz à fin 2022, CDC Habitat entend accélérer la transformation de son mix énergétique en intégrant des solutions toujours moins carbonées (chauffage électrique, biomasse, solaire thermique, solaire photovoltaïque…), en travaillant avec les collectivités pour raccorder ses résidences aux réseaux de chaleur locaux, ou encore en favorisant des solutions innovantes comme l’autoconsommation collective.
En parallèle, le Groupe continue de travailler sur les questions de sobriété énergétique mais aussi hydrique ou foncière – avec notamment une réflexion autour de la désartificialisation des sols. La plupart des actions mises en place fin 2022 dans le cadre du plan de sobriété énergétique seront pérennisées, afin de sensibiliser dans la durée ses équipes comme ses locataires aux nouveaux usages à adopter pour moins consommer, notamment en hiver.
Poursuivre l’anticipation et l’adaptation aux changements climatiques
Parce qu’il vise à maîtriser et à réduire les consommations énergétiques et les émissions de CO2, le Plan Stratégique Climat est complémentaire du plan d’adaptation au changement climatique lancé par CDC Habitat fin 2022. Celui-ci vise en effet à identifier les risques climatiques actuels et futurs et à adapter le patrimoine et sa gestion afin notamment de préserver le confort, la sécurité et la qualité de vie des habitants.
L’anticipation des aléas permettra également de limiter les nouveaux besoins en énergie – la hausse des températures probable ne pouvant par exemple être uniquement traitée par l’ajout de systèmes de climatisation fortement énergivores. En s’appuyant notamment sur le DPR (Diagnostic Performance Résilience) et sur la cartographie des risques réalisée en interne, CDC Habitat entend adapter ses interventions et sa programmation, et favoriser la mise en place de réponses compatibles avec l’objectif de 1,5°C.

3 questions à… Alain Cauchy, directeur en charge de la mission Décarbonation du groupe CDC Habitat
« Derrière la réponse au défi climatique, il y a tous les autres enjeux du logement »
Pourquoi avoir choisi d’élargir la démarche énergétique Groupe à un plan climat ?
Le plan stratégique énergétique que nous déployons depuis 2008 se concentrait principalement sur la performance énergétique de notre patrimoine, avec pour principal indicateur les consommations en énergie primaire – que nous avons réussi à réduire de 229 à 134 à kWhep/m2 /an en 15 ans et que nous souhaitons abaisser à 80 kWhep/m2 /an d’ici à 2050 avec un premier palier de 110 kWhep/m2 /an en 2030. S’il s’agit toujours d’un axe majeur de notre stratégie, mais le contexte de hausse du coût des énergies et des matières premières nous rappelle que la question de la décarbonation de notre mix énergétique doit être remise au premier plan. D’où la volonté de compléter et d’élargir notre réflexion, en remettant un autre indicateur, celui des émissions de gaz à effet de serre, au cœur de l’équation.
Le Groupe est déjà en pointe sur les questions environnementales : il y avait urgence à accélérer ?
Le changement climatique, nous le vivons tous au quotidien. Et sur un patrimoine comme celui de CDC Habitat, les conséquences sont multiples. Réduire nos consommations énergétiques et nos émissions de CO2 doit aller de pair avec un travail d’anticipation des risques et d’adaptation de notre patrimoine aux aléas climatiques – en neuf comme en réhabilitation. Nous allons définir un PMT à l’horizon 2033 qui sera réévalué chaque année et qui, au-delà de la réponse au défi climatique, va continuer à intégrer toutes les autres problématiques liées au logement : vieillissement de la population, sécurité, attractivité des territoires… Le climat ne prend pas le pas sur les autres sujets, il englobe tout.
Vous entendez porter ces sujets collectivement ?
Notre volonté est clairement d’entraîner avec nous toutes nos parties prenantes, des collectivités qui soutiennent nos projets aux promoteurs auxquels nous achetons des programmes en VEFA en passant par les entreprises à qui nous allons proposer des cahiers des charges de plus en plus exigeants. Aujourd’hui, comme toutes les filiales de la Caisse des Dépôts, nous choisissons de partir sur le scénario de la trajectoire 1,5°C, alors que jusque-là, notre plan stratégique énergétique s’inscrivait dans la stratégie bas carbone nationale basée sur l’hypothèse d’une hausse des températures de 2°C d’ici à 2050. C’est un choix qui va évidemment avoir des conséquences sur notre activité et qui va nous demander d’adapter nos méthodes mais il est de notre responsabilité d’être ambitieux sur ces questions.

Des petites unités de vie de huit à dix personnes, au cœur des villes, accompagnées par des aidants professionnels…Domani, partenaire de CDC Habitat, a créé une alternative aux Ehpad qui répond aux aspirations profondes de nos aînés. Un modèle qui a le vent en poupe, comme l’explique Oscar Lustin, cofondateur de l’entreprise agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, avec Jean de Miramon.

Comment est né le projet Domani ?
Nous avons cofondé Domani en 2020 avec Jean de Miramon, après avoir travaillé dans l’hébergement d’urgence et l’investissement à impact.
Domani est née du souhait de proposer aux personnes âgées une alternative au maintien à domicile, à l’Ehpad et aux résidences seniors.
En quoi consiste cette alternative ?
Quand on interroge les personnes âgées, on s’aperçoit qu’elles souhaitent toutes majoritairement la même chose : rester chez elles, sans être seules. Nous avons donc conçu un modèle d’habitat partagé de type « familial », avec des petits lieux de vie pour 8 à 10 habitants qui bénéficient à la fois d’un espace privatif et d’espaces partagés, et d’un accompagnement adapté à leurs souhaits et à leurs besoins.
Quels sont les avantages, par rapport aux résidences seniors ?
Pour ceux qui connaissent un début de perte d’autonomie, Domani est une solution intéressante, pour une raison de taille. Une résidence seniors compte en général 80 à 100 personnes. Le restaurant est loin des chambres, il n’est pas facile de le rejoindre quand la mobilité est restreinte et qu’on se déplace en déambulateur. Domani correspond à un « entre deux » : des personnes qui ne sont pas autonomes à 100 %, mais qui ne sont pas non plus dépendantes au point de devoir rejoindre un Ehpad. La moyenne d’âge de nos habitants est de 88 ans. Certains sont d’ailleurs passés par une résidence seniors avant rejoindre l’habitat partagé Domani.
Comment vit-on dans une structure Domani ? Pourriez-vous décrire le quotidien des habitants ?
Chaque habitant dispose d’un espace privatif d’environ 30 m² avec chambre et salle de bain pour mettre ses meubles, recevoir sa famille… et en même temps d’espaces communs où il peut préparer et partager des repas. Les personnes âgées sont accompagnées par des professionnels aidants salariés de Domani, soit deux équivalents temps plein. C’est très sécurisant pour les habitants : ils sont équipés de bracelets en cas d’urgence et bénéficient d’une présence 24 h sur 24, grâce à un système d’astreinte. En moins de deux minutes, si besoin, ils peuvent être accompagnés.
C’est aussi un mode de vie très convivial où les personnes âgées restent maîtres de leurs désirs, de leurs envies. C’est d’ailleurs quelque chose qui surprend au départ les habitants.
C’est à dire ?
Dans un habitat partagé Domani, on vit vraiment avec les autres habitants, comme dans une colocation . Pour la nourriture, un système de livraison a été mis en place. Mais les habitants, s’ils le souhaitent, ont toujours la possibilité d’aller au marché pour choisir eux-mêmes leurs légumes. Pour les repas, chacun aide comme il peut et comme il veut. Ceux qui sont fatigués donnent leurs recettes, les autres sont au fourneau. Une fois par mois, on réalise le rêve de quelqu’un. C’est ainsi qu’un groupe de colocataires s’est retrouvé dans le bassin d’Arcachon pour manger des huîtres.
Cette ambiance quasi familiale est favorisée par le management assez innovant que nous avons mis en place pour les aidants. Il n’y a pas de hiérarchie, l’équipe est totalement autonome et fonctionne grâce à une boucle Whatsapp. Cela plaît beaucoup aux aidants et contribue sans doute à la réussite de ces petites unités de vie.
L’autre intérêt de Domani est la situation de cet habitat partagé, au cœur de la cité ?
Qui dit « habitat inclusif » dit en effet cœur de la cité. L’idéal type, c’est d’être sur la place du marché, au pied de l’église, et non pas en « troisième couronne ». Pas question de créer des « ghettos de vieux »! A Mimizan, par exemple, une unité que nous avons inauguré avec CDC Habitat en janvier 2023, nous sommes à deux pas de la promenade de bord de mer, en face du marché. Et ceci, dans un bâtiment qui accueille des logements « classiques », ou des colocations étudiantes dans certains cas, pour une réelle mixité générationnelle.
Ces petites structures correspondent clairement à un chaînon manquant entre l’Ehpad et le maintien à domicile, pourquoi ne sont-elles pas nées avant ?
Ce modèle d’habitat existait déjà, tout d’abord au Danemark et au Royaume-Uni, au Canada. Nous nous sommes d’ailleurs inspirés de ces expériences pour monter notre projet. En France, l’intérêt pour ces formules est venu plus tard. En 2018, la loi Elan a donné un cadre légal à l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Avant cette loi, les agences régionales de santé étaient en droit de fermer ces structures. Le rapport remis à l’été 2020 par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom a joué aussi un rôle important en préconisant l’arrêt de construction des Ehpad et la construction de 150 000 places en habitat partagé à l’horizon 2020… Nous en sommes encore loin, avec 5 000 places aujourd’hui, mais la tendance est là. Les Ehpad vont de plus en plus se spécialiser dans la très grande dépendance et les autorisations de construction d’Ehpad se feront de plus en plus rares.
Quel est le coût d’une colocation chez Domani, par rapport à l’hébergement en Ehpad ?
A niveau de services équivalent, Domani coûte environ 20 % moins cher qu’un hébergement en Ehpad.
Où en êtes-vous dans votre développement et quel type de partenariat avez-vous noué avec CDC Habitat ?
Nous avons inauguré une première unité à Pessac, en 2021, puis une deuxième avec CDC Habitat au cœur de Mimizan Plage que j’ai déjà évoquée et nous avons actuellement cinq chantiers en cours. La Banque des Territoires a investi dans Domani dès son lancement et nous avons signé avec CDC Habitat un très beau partenariat pour 101 logements inclusifs d’ici 2024 répartis sur six communes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Parallèlement, nous avons signé un protocole avec un « droit de premier ordre », c’est à dire que chaque fois que nous développons un projet, nous le proposons à CDC Habitat.
C’est un partenariat très fructueux, CDC Habitat nous accompagne dans le portage des murs et le développement territorial. Nous travaillons main dans la main avec ses directions interrégionales et allons voir les élus ensemble pour faire naître des projets associant du logement social, libre ou intermédiaire et un habitat partagé, pour assurer cette mixité intergénérationnelle que nous recherchons.
Constatez-vous un intérêt croissant des collectivités pour ce type d’habitat ?
Incontestablement, l’habitat inclusif intéresse de plus en plus d’élus. Ces derniers sont en première ligne et se posent beaucoup de questions sur le vieillissement de la population et le bien vieillir : qu’est-ce qu’on veut pour nos aînés ? Quelles solutions d’hébergement souhaite-t-on leur offrir ? Ils sont séduits par le côté innovation sociale de Domani et sont très rassurés par la présence d’un opérateur de l’habitat d’intérêt public de l’envergure de CDC Habitat. Ils n’ont pas envie de laisser ce sujet dans les mains d’opérateurs privés à 100 %.
La commune de Blagnac, par exemple, avait refusé des projets de résidences services seniors avant de choisir notre solution. Le maire de Saint-Denis-d’Oléron a contacté les équipes de la direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat parce qu’il était intéressé par cette alternative. De plus en plus de collectivités se tournent vers l’habitat inclusif et nous recevons beaucoup plus de sollicitations que nous ne l’avions imaginé. Passé le temps de la sidération, après les révélations du livre « Les fossoyeurs », les élus veulent passer à l’action et trouver des solutions concrètes.

Interview de Gaëlle Nerbard, directrice nationale outre-mer de la Croix Rouge française.
En outre-mer, la vulnérabilité des populations croise souvent les difficultés de logement. Pour renforcer ses actions auprès des plus fragiles, la direction nationale outre-mer de la Croix-Rouge française a signé en septembre 2022, une convention avec CDC Habitat. Les explications de Gaëlle Nerbard, directrice nationale outre-mer de l’association.

Pourriez-vous nous décrire les différentes actions de la Croix-Rouge dans les territoires d’outre-mer ?
La Croix-Rouge a une responsabilité particulière en outre-mer : nous sommes la seule association nationale présente sur les onze territoires ultramarins. Nous avons donc une vision à 360 ° sur les vulnérabilités de leurs habitants. Cette responsabilité est d’autant plus grande que les besoins sur ces territoires sont immenses et nos modalités d’intervention nombreuses. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics pour secourir les populations face aux catastrophes naturelles, aux situations d’urgence, aux crises sociales. A titre d’exemple, lors de la tempête Fiona, en Guadeloupe, nous avons notamment été mobilisés pour produire de l’eau potable. En 2 semaines, nous avons pu distribuer plus de 70 000 d’eau à la population.
En dehors de ces situations d’urgence, nous accompagnons toutes les personnes vulnérables, depuis la crèche jusqu’à l’Ehpad en passant par l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ou des femmes victimes de violence. Nous faisons aussi de la prévention spécialisée, avec des éducateurs de rue qui interviennent dans les quartiers les plus défavorisés. Notre accompagnement social est global et prend en compte tous les aspects : précarité alimentaire,, santé (soins à domicile, centres de santé, lutte contre les addictions), insertion, accès aux droits, aide aux victimes, hébergement, etc.
Quelles sont les difficultés de ces territoires en matière de logement ?
L’immobilier est en forte tension, ce qui accroît les vulnérabilités des populations. La plupart des personnes que nous accompagnons ont des difficultés de logement et vivent dans les plus de 12 % d’habitats indignes et insalubres du parc ultramarin. Cela rend beaucoup plus compliqué pour eux l’accès aux services publics, à la santé, la scolarisation, la formation, l’insertion… Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 80 % des ménages ultramarins ont droit à un logement social, mais seulement 18 % en occupent un.
Le foncier est un vrai problème en outre-mer. Il est rare, cher, notamment dans les Antilles, en Guyane ou à La Réunion. Ces territoires font partie de ceux où se loger coûte le plus cher en France.
Pourquoi la Croix-Rouge française a-t-elle souhaité se rapprocher de CDC Habitat par une convention ?
Les liens ne sont pas nouveaux. Nous collaborons depuis plusieurs années avec les SIDOM, les filiales de CDC Habitat en outre-mer, sur différents dispositifs. Nous avons souhaité poursuivre notre partenariat et aller encore plus loin en formalisant l’ensemble de nos collaborations par une convention.
Cette convention permet à la fois de faire un état des lieux de notre immoblier, d’identifier des solutions d’hébergement pour les plus vulnérables de notre association, d’accompagner le développement de nos activités en identifiant des locaux permettant de les héberger et de loger des salariés qui répondent aux critères du logement social. Elle vise aussi à favoriser l’accès à nos dispositifs d’accompagnement social pour les locataires des résidences gérées par CDC Habitat. De plus en plus, nos interventions sont mobiles, car nous privilégions « l’aller-vers » les populations. Mais même avec des équipes mobiles, il faut un lieu pour se poser, disposer d’un ordinateur, opérer la transmission d’une équipe à une autre… Or, nous voyons bien que le développement de nos activités bute sur la question des locaux et de la rareté des logements.
Le partenariat avec CDC Habitat, un acteur de référence sur le logement, est très précieux pour nous. C’est un partenariat gagnant-gagnant qui engendre un cercle vertueux puisqu’il vise également à favoriser l’accès à nos dispositifs d’accompagnement social pour les locataires des résidences gérées par CDC Habitat.
Quels types de projets souhaitez-vous développer ensemble ?
Cela diffère selon les territoires. A La Réunion, nous répondons conjointement à un appel à projet concernant un Ehpad. A Mayotte, nous projetons d’ouvrir une crèche et nous cherchons de nouveaux locaux, car nos activités sont en plein développement. Nous souhaitons aussi sécuriser les personnes que nous accompagnons et nos collaborateurs qui sont situés dans des zones où l’insécurité est forte, en les délocalisant. En Martinique, nous répondons avec la Simar à un appel à manifestation d’intérêt concernant la ville du Lamentin. En Guyane, nous manquons de solutions d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile et nous nous sommes tournés vers la Siguy et la Simko. Nous souhaitons aussi y développer une nouvelle activité, l’intermédiation locative.
En quoi consiste-t-elle ?
Certaines des personnes que nous accompagnons ont de telles difficultés qu’ils ne sont pas prêts à vivre seuls, sans soutien, dans un appartement. L’objectif de l’intermédiation locative est de les mettre sur le chemin de l’autonomie. La Croix-Rouge se substitue au locataire dans la relation au bailleur : le contrat a lieu avec elle et non pas avec le locataire.
Le renforcement de nos liens avec les SIDOM va nous permettre de réaliser ce projet et plus globalement, de faire connaître nos services, nos centres de santé, nos différents dispositifs aux locataires des SIDOM. C’est toute la question, majeure, d’une plus grande accessibilité aux dispositifs de soutien et d’accompagnement des plus vulnérables…

Aude Debreil, nouvelle présidente du directoire de Grand Paris Habitat, revient en détail sur le plan de soutien au logement annoncé par CDC Habitat en mai dernier et la manière dont il va être déployé en Île-de-France.

3 milliards d’euros investis, 17 000 logements à produire en 3 ans : comme en 2020 avec le plan de relance, CDC Habitat continue de se mobiliser dans un contexte particulier…
Il y a effectivement urgence à soutenir la production dans les zones les plus tendues où la demande reste extrêmement forte. 55 % de ce plan de soutien pourrait concerner l’Île-de-France, soit 9 000 à 9 500 logements supplémentaires sur 3 ans qui viendront s’ajouter aux volumes habituels – plus de 5 000 logements seront livrés rien qu’en VEFA en 2023. La particularité de ce plan de soutien est de se concentrer sur les deux piliers que sont le logement social et le logement intermédiaire : CDC Habitat s’était largement engagé en faveur du logement abordable contractualisé dans le plan de relance de 2020, nous voulons aujourd’hui agir sur un autre front. Tout cela va se faire dans un contexte économique difficile, avec une hausse du livret A et des taux d’intérêt, des prix des matières premières et de l’énergie toujours élevés, il va donc nous falloir être très sélectifs. Mais le marché a besoin de cette impulsion.
Outre l’aspect financier, quels sont les critères qui vont orienter vos choix ?
Le premier critère qui nous guide, c’est la pertinence du projet au regard du marché local. Les agences de proximité de CDC Habitat sont systématiquement impliquées dans le processus de sélection des projets car elles ont une vraie connaissance des dynamiques locales et des besoins de chaque collectivité. Le second critère, c’est évidemment l’aspect technique : notre Groupe a toujours affiché ses ambitions en termes de qualité de construction, et les projets doivent donc être cohérents avec nos exigences. Enfin, le troisième critère, qui va de pair avec le précédent, c’est évidemment la qualité environnementale des projets : le Groupe s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de 23 kilos de CO2 par m² aujourd’hui à 15 kilos en 2030 : pour y parvenir, il faut qu’au moins un quart des opérations menées affichent des performances équivalentes ou supérieures au seuil 2025 de la RE 2020.
Pour y parvenir, vous voulez mener davantage de projets en maîtrise d’ouvrage directe…
C’est effectivement l’un des axes stratégiques portés par Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, depuis son arrivée. Pour répondre en profondeur aux besoins des territoires, il nous faut avoir la main sur les projets, en maîtriser la conception et les orientations jusque dans le moindre détail. Or, Grand Paris Habitat est parfaitement apte à mener des projets en MOD : nous avons constitué des équipes spécifiques avec des développeurs attachés à chaque département, mais aussi des spécialistes de la programmation et de la conception, des urbanistes, une cheffe de projet BIM… Tout cela nous permet d’atteindre des volumes conséquents, avec des prévisions de permis de construire pour 1 000 logements sur 2023-2024.



Comment vous préparez-vous à gérer ce supplément de travail ?
La particularité de CDC Habitat en Île-de-France est d’avoir scindé son activité en deux entités, avec d’un côté la Direction interrégionale qui exerce l’activité de bailleur-gestionnaire, et de l’autre le GIE Grand Paris Habitat en charge du développement et maîtrise d’ouvrage directe – en construction neuve comme en intervention lourde (réhabilitation, résidentialisation, démolition, projets ANRU…). Cette répartition des rôles est une force car elle permet de s’appuyer sur deux spécialistes aux compétences complémentaires et qui ont l’habitude de travailler ensemble, pour porter des volumes particulièrement conséquents. Aujourd’hui, notre GIE compte vingt adhérents hors groupe CDC Habitat, soit 24 au total, 160 collaborateurs, et 70 % de notre activité consiste à porter des projets pour le compte de CDC Habitat. Mais le fait que nous accompagnions d’autres organismes de logements sociaux nous permet d’avoir un regard ouvert sur les territoires et sur nos métiers.
Le projet de territoires va être un autre outil pour déployer ce plan de soutien ?
Nous avons effectivement travaillé avec les équipes d’Éric Dubertrand, directeur interrégional de CDC Habitat Île-de-France, à l’actualisation du projet de territoires. Lors de son élaboration initiale en 2021, le projet de territoires avait une très forte connotation « développement ». A l’occasion de sa mise à jour, nous avons souhaité mieux articuler les enjeux de développement avec ceux de gestion patrimoniale et de gestion locative. Un état des lieux a été réalisé pour chaque intercommunalité et des plans d’action ont été bâtis pour chaque territoire sur l’ensemble des sujets. Tout cela va nous permettre de décloisonner notre approche et de gagner en efficacité. Enfin, nous avons souhaité tirer ensemble, direction interrégionale et GPH, les enseignements du plan de relance de 2020 : pour faire évoluer nos processus, fluidifier nos échanges et nous allons pouvoir mettre cette expérience à profit pour porter ce nouveau plan au niveau opérationnel.
Le plan de soutien en quelques chiffres :
- 3 milliards d’euros d’investissement sur 3 ans
- 17 000 logements portés dans toute la France, en VEFA comme en MOD, dont :
- 12 000 logements intermédiaires
- 5 000 logements sociaux

Entre maintien à domicile et développement de résidences gérées, CDC Habitat travaille activement en Auvergne-Rhône-Alpes sur la question du logement des seniors. Un séminaire interne s’est tenu en février dernier afin de définir une feuille de route pour les prochaines années.
Avec plus de 8 millions d’habitants, la région Auvergne-Rhône-Alpes reste la deuxième région la plus peuplée de France, après l’Île-de-France. Et comme l’ensemble du pays, le territoire connaît une accélération du vieillissement de sa population. Dans sa dernière projection présentée en mai 2023, le CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) AURA, s’appuyant sur le recensement de 2018, prédisait une hausse de la population d’environ 8,5 % d’ici 2050, s’accompagnant d’une hausse de la part des seniors à 12 seniors pour 10 jeunes (contre 8 seniors pour 10 jeunes actuellement).
« On observe depuis quelques temps une hausse du nombre de locataires de plus de 60 ans sur notre patrimoine, avec néanmoins des disparités d’une zone à l’autre », confirme Lucile Barou, directrice adjointe de CDC Habitat AURA. « Les grandes villes comme Lyon, Annecy, Grenoble ou Clermont-Ferrand continuent d’attirer des jeunes, des familles et maintiennent globalement un bon équilibre de la pyramide des âges, mais d’autres territoires comme Vichy, le Puy-de-Dôme ou l’Isère voient leur population vieillir de manière assez significative ».
Un séminaire local pour faire le tour de la question
En matière d’habitat, cette question du vieillissement résonne de multiples manières. Si l’on vieillit globalement mieux et de manière plus autonome qu’il y a quelques décennies, le maintien à domicile souhaité par une grande partie des seniors nécessite a minima un logement adapté – pas toujours compatible avec le patrimoine ancien. Du côté de l’habitat collectif, la création d’EHPAD est strictement encadrée et ne peut se faire qu’en réponse un appel à projet lancé par le préfet, l’ARS ou le Conseil Départemental. D’autres formats de résidences gérées, plus ou moins médicalisées, voient également le jour depuis quelques temps, mais elles nécessitent de s’appuyer sur des spécialistes et des professionnels de santé largement débordés.
Pour toutes ces raisons, la direction Auvergne-Rhône-Alpes de CDC Habitat a organisé en février dernier un séminaire interne « Habitat et seniors » à Lyon, afin de réunir l’ensemble des métiers et compétences autour de la question l’accompagnement du vieillissement. « Plus de 120 collaborateurs ont participé à ce rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de notre projet de territoires », reprend Lucile Barou. « Nous avons établi une feuille de route avec 4 grands axes (voir encadré) qui vont nous permettre d’avoir une approche plus fine de ces questions, et d’apporter des réponses à chaque étape et chaque besoin – de l’adaptation de notre patrimoine jusqu’au développement de nouveaux projets collectifs de type EHPAD, en passant par le renforcement de notre offre de service autour du coliving ou de la colocation intergénérationnelle ».
Le GIE Générations, un outil précieux de développement
Si la direction régionale dispose de l’essentiel des compétences pour mener à bien ces projets, elle peut néanmoins s’appuyer, pour des projets plus complexes, sur le GIE Générations : le pôle dédié aux résidences gérées et au médico-social créé en 2020 par CDC Habitat. Comme le souligne Delphine Pavy, directrice du GIE Générations, « notre mission est d’accompagner les bailleurs dans le développement et l’entretien des résidences gérées par des exploitants externes à destination des jeunes comme des seniors. Nous intervenons aussi bien en amont sur le développement de projets et l’acquisition/amélioration d’actifs, qu’en phase de maîtrise d’ouvrage, sur la gestion financière ou sur tout ce qui concerne la maintenance et la sécurité de ce patrimoine très particulier et qui nécessite une vraie expertise ».
Le GIE qui compte aujourd’hui 4 adhérents dont CDC Habitat, 25 collaborateurs et 305 établissements en exploitation sur l’ensemble du territoire, accompagne localement les projets comme celui de l’EHPAD de Chasse-sur-Rhône (38). CDC Habitat s’est en effet porté acquéreur de la SCI EHPAD LTR, propriétaire de l’EHPAD public « Les Terrasses du Rhône », via la foncière médico-sociale créée en 2020 avec Ampère Gestion et des partenaires institutionnels. Le site qui a ouvert ses portes en 2018 et propose une centaine de lits et un PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) gérés par le Centre hospitalier de Vienne, va pouvoir bénéficier d’un soutien technique et financier de la part du Groupe pour stabiliser son activité.
« Le parc médico-social nécessite de forts investissements pour adapter les constructions aux standards actuels de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique. Les gestionnaires notamment associatifs et publics recherchent des bailleurs partenaires à même de porter cette nouvelle dynamique », reprend Delphine Pavy. « Au total, le GIE s’est engagé à investir 800 millions d’euros sur 5 ans, dont 400 via la foncière médico-sociale pour soutenir spécifiquement les gestionnaires et les hôpitaux qui participent activement à faire émerger des réponses aux enjeux actuels du vieillissement de la population ».
« C’est une force pour nous de pouvoir nous saisir de cette question du vieillissement à tous les niveaux, avec à la fois des compétences en interne au niveau des équipes locales et l’appui de spécialistes sur des questions très précises au national avec le GIE Générations », conclut Lucile Barou. « Cela nous permet de répondre à un très large éventail de demandes des collectivités, qu’il s’agisse d’adapter le patrimoine existant pour favoriser le maintien à domicile, d’imaginer d’autres types d’habitats autonomes pour les seniors, ou d’accompagner la gestion, notamment technique, des 10 EHPADs dont nous sommes propriétaires au niveau de la DIR ».
En résumé
Les 4 axes de la feuille de route « seniors » de CDC Habitat en Auvergne-Rhône-Alpes
- Déployer une dynamique d’aller vers pour renforcer les interactions avec ce public isolé.
- Faciliter l‘adaptation des logements et l’accessibilité des espaces communs au public senior.
- Concevoir des services adaptés qui répondent aux besoins spécifiques des seniors.
- Renforcer le lien social et l’intergénérationnel au sein des résidences.
Le GIE Générations : un expert aux côtés des équipes de terrain
- 4 adhérents.
- 25 collaborateurs.
- 305 ensembles immobiliers en exploitation au sein de CDC Habitat.
- 800 millions d’euros investis en 5 ans, dont 400 millions dans le secteur médico-social via une foncière dédiée.

Interview de monsieur François Grosdidier- Maire de Metz et Président de l’Eurométropole de Metz

Pourriez-vous décrire les ambitions de l’Eurométropole de Metz en matière de logement et d’habitat ?
A travers le troisième Programme local de l’habitat (PLH) de l’Eurométropole, nous agissons à la fois sur la quantité, en favorisant la production de logements de manière équilibrée, commune par commune, et la qualité, en rénovant l’ancien. Les questions de rénovation énergétique sont plus que jamais d’actualité.
Depuis 2021, l’Eurométropole est délégataire des aides à la pierre ce qui lui permet de délivrer agréments et subventions aux bailleurs publics mais aussi aux ménages plus modestes dans le cadre de l’ANAH.
La difficulté réside dans le fait que le territoire est très varié, avec des communes très urbaines (6 quartiers politique de la ville dont 4 concernés par l’ANRU), des besoins importants en matière de réhabilitation du parc ancien, et des communes plus rurales qui souhaitent conserver leur cadre de vie tout en captant des jeunes ménages.
Cette diversité constitue aussi une richesse avec des paysages naturels à préserver. L’objectif pour l’Eurométropole est de regagner en population en proposant une offre de logement diversifiée et accessible à tous.
En termes de typologie d’habitat et de logement, quelles sont vos priorités ?
Tous les types de logement pour répondre au(x) besoin(s) ! Nous soutenons le développement du logement social, en particulier dans les petites communes, où les bailleurs n’allaient pas spontanément. Nous avons majoré les aides dans ces secteurs jusqu’à 15 000 euros par logement (pour 2 000 à 4 000 € auparavant). Il nous faut également résorber le déficit en logement sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants qui en manquent, comme Longeville-lès-Metz.
Nous aidons aussi les jeunes ménages à accéder à la propriété, afin d’éviter qu’ils ne s’installent dans les territoires voisins parce que le logement y est moins cher.
Enfin, un étudiant messin sur deux est logé chez ses parents. Nous continuons néanmoins à améliorer la qualité de l’offre actuelle, notamment celle du CROUS qui en avait besoin, et de nouvelles opérations sont prévues, comme la reconversion du bâtiment de l’Urssaf par VIVEST à Metz, la rénovation de la résidence Edouard Branly par la SEM Eurométropole Metz Habitat au Technopole, et une nouvelle résidence VILOGIA rue aux arènes à Metz.
Qu’attendez-vous de CDC Habitat ?
Pour bien comprendre les raisons de cette transformation, rappelons la situation.
Plus de 13 000 logements sociaux de l’Eurométropole de Metz étaient jusqu’à présent gérés par un office public, l’OPHMM en souffrance. Très peu de travaux de rénovation ont été entrepris ces quinze dernières années sur le parc.
Les travaux nécessaires à la réhabilitation du parc ont été chiffrés à plusieurs centaines de millions d’euros.
L’OPH ne possédant pas la capacité financière suffisante pour engager ce programme, nous avons cherché des solutions pour y remédier et la création d’une SEM en était une.
Pour ce faire, l’Eurométropole a noué un partenariat avec CDC Habitat et sa filiale Adestia. Celle-ci a apporté 35 millions d’euros au capital de la nouvelle structure.
Outre ce soutien financier, CDC Habitat va nous apporter également son expertise en tant qu’acteur majeur du logement social en France.
En 2021, l’OPH de Metz Métropole est donc devenu une SEM, dont CDC Habitat est actionnaire. Qu’attendez-vous de ce rapprochement ? Qu’est-ce que cela a changé ?
Un Plan stratégique de patrimoine a été établi, programmant 381 millions d’euros d’investissements sur dix ans, destinés à la réhabilitation du parc de logements, au renforcement de l’offre et à la montée en qualité du parc. La stratégie élaborée s’appuie également sur d’importants moyens humains.
Aujourd’hui dotée d’un capital de 181 M€, la société dont l’Eurométropole reste majoritaire à 80 % a désormais de nouveaux moyens pour construire des logements de qualité, rénover ses logements vacants et les remettre sur le marché plus rapidement, et engager un vaste programme de réhabilitation de ses logements existants dans les 10 prochaines années.
Comment prenez-vous en compte l’impératif de sobriété foncière et comment l’articulez-vous avec la nécessité de construire des logements ?
Jusqu’à présent, le rêve de nombreux ménages était souvent de construire leur maison individuelle. Cependant, aujourd’hui nous devons moins artificialiser les sols, et n’avons plus la possibilité de consommer autant de foncier. Notre Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration et prendra cela en compte. Il faut travailler avec l’existant, remettre sur le marché les logements vacants, de plus en plus nombreux. Aussi, nous intervenons pour résorber l’habitat dégradé, en lien avec l’ANAH et notre opérateur agrée le CALM-Soliha (Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle) qui accompagne les ménages dans leur projet de rénovation ou d’adaptation de leur logement. Nous encourageons également les formes urbaines moins consommatrices en foncier, par exemple les logements intermédiaires avec entrées et espaces extérieurs privatifs.
Le recyclage de foncier déjà aménagé est-il une piste que vous envisagez ?
Tout à fait, la reconversion des friches est une solution pour limiter l’étalement urbain et la Métropole en compte de nombreuses, que ce soit une base aérienne de 400 hectares, des anciennes casernes et des hôpitaux. Avec le Zéro artificialisation nette (Zan), leur reconversion est devenue une chance.
Leur transformation est néanmoins complexe, et longue, à l’image du quartier de l’Amphithéâtre à Metz. Ainsi plusieurs années sont nécessaires, pour transformer ce site très pollué en un quartier de 1650 logements intégrant un établissement culturel totem, le Centre Pompidou Metz.
De même pour le Plateau de Frescaty qui accueille aujourd’hui une centaine d’entreprises dont Amazon et le Centre de formation du FC Metz. Depuis l’implantation d’Amazon, beaucoup d’entreprises logistiques souhaitent s’installer et on va finir par manquer de place d’autant que nous souhaitons également installer des activités artisanales et tertiaires sur la Base vie, une zone de 25 hectares.
Plus globalement, comment prenez-vous en compte les impératifs de la transition énergétique dans l’Eurométropole? Sur quels leviers jouez-vous, du point de vue de l’habitat, du développement urbain, des mobilités ?
Sur l’habitat, nous avons déployé tous les dispositifs existants aujourd’hui permettant d’aider les propriétaires bailleurs et surtout les propriétaires occupants sous plafond de ressources pour rénover ou adapter leur logement (OPAH, OPAH-Copropriétés, programme SARE). Au vu de l’urgence climatique et du coût des énergies, nous devons accélérer la rénovation du parc existant et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) doit devenir la porte d’entrée de tous les habitants pour obtenir informations et conseils et mener à bien leur projet.
L’Eurométropole a gagné en 2022 la Marianne d’or pour les navettes fluviales Metz’O. Cette initiative concilie les enjeux de Metz ville d’eau, ressource naturelle pour laquelle une vigilance accrue est nécessaire, et les enjeux de la mobilité dont elle constitue un élément parmi tous les modes de transport. Par ses aspects ludiques, elle invite les habitants à découvrir l’utilisation du réseau Le Met’, pour lequel la Métropole améliore l’attractivité par l’extension du réseau METTIS, et réduit l’empreinte carbone par une politique volontariste de développement de l’hydrogène.
Pour assurer la transition énergétique en matière de mobilité, nous ne comptons pas opposer les modes de transport les uns aux autres. Nous favorisons l’élargissement du panel des solutions mises à la disposition des habitants de la Métropole et de ses visiteurs. Outre l’amélioration des transports collectifs, cette ambition se traduit par la mise en œuvre d’un ambitieux plan de développement des aménagements cyclables, mais également par le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le domaine public.
A l’heure où l’on parle beaucoup de « désamour » pour les métropoles, quelle est votre vision de l’avenir de l’Eurométropole de Metz, de ce qu’elle peut et doit être ?
Certainement pas le désamour. L’Eurométropole peut et doit être le vecteur d’ambitions convergentes. Des ambitions qui répondent à la fois aux enjeux du siècle, mais aussi et surtout aux attentes des habitants et communes du territoire messin.
Cela implique une attention portée tout autant à la rénovation énergétique de nos bâtiments, au soin porté à l’aménagement de notre territoire et aux offres de logement proposés à ses habitants, qu’au développement de mobilités complémentaires ou encore à l’attractivité économique et touristique de notre Eurométropole.
Ma vision de l’avenir est donc résolument pragmatique et engagée. Elle est par ailleurs pour partie déjà en train de se réaliser.

Isolant biosourcé d’origine végétale, le béton de chanvre est de plus en plus utilisé dans le bâtiment en remplacement des matériaux traditionnels d’origine minérale et synthétique. Briefing sur un éco-matériau qui multiplie les performances, et sur une expérimentation innovante de Maisons & Cités dans les Hauts-de-France.
Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
Le béton de chanvre est composé de chènevotte – en quelque sorte la « moelle » de la tige de chanvre, appelée aussi « paille de chanvre » –, de chaux et d’eau. Il n’a donc rien à voir avec le béton, mais il est lui aussi un assemblage de granulats et d’un liant, qui peut être utilisé de la même manière, en construction ou rénovation, soit moulé, soit coulé ou versé dans un coffrage, soit projeté !
C’est un isolant naturel, biosourcé, que l’on appose en rénovation à l’intérieur des bâtiments, sous forme de blocs, de panneaux préfabriqués, ou en projection sur les parois.
C’est le matériau retenu par le bailleur social Maisons & Cités pour une expérimentation grandeur nature de réhabilitation d’un parc de logements miniers des Hauts-de-France, à Pecquencourt.

Quels sont ses atouts par rapport à un isolant traditionnel ?
Par rapport aux isolants les plus utilisés comme la laine de verre, peu coûteuse mais issue d’ingrédients faiblement renouvelables (le sable et le verre) et d’un processus de fusion consommateur d’énergie, ses atouts sont avant tout écologiques. Le chanvre est 100 % renouvelable, biodégradable, sa culture consomme peu de ressources et n’appauvrit pas les sols puisqu’elle ne nécessite ni eau ni pesticide. Elle est même source d’enrichissement pour la terre. Sa transformation en granulats est purement mécanique, utilise peu d’énergie et émet peu de CO2. Et encore mieux : le chanvre est un absorbeur de carbone, comme les forêts !
Il a aussi beaucoup d’atouts en matière de performance d’isolation et de confort pour les résidents, puisqu’on parle même pour lui de « performances hygrothermiques exceptionnelles ». Les tests menés par Maisons & Cités montrent notamment que son assimilation de la vapeur d’eau est bien plus élevée que les autres isolants : il laisse respirer les murs et c’est un très bon régulateur d’humidité (ce qui s’avère particulièrement intéressant dans une région comme les Hauts-de-France, et pour la réhabilitation de logements en briques, relativement poreuses). Il a aussi des qualités d’isolation acoustique, grâce à sa structure « caverneuse ».
En termes de qualité de l’air intérieur, puisqu’il est cultivé sans intrants chimiques, il fait partie des matériaux qui n’émettent pas de composants organiques volatiles (COV) potentiellement toxiques.
Enfin, d’un point de vue pratique pour les professionnels du bâtiment : il est léger (6 fois plus que le « vrai » béton), fluide et utilisable sous plusieurs formes selon les caractéristiques du chantier concerné.
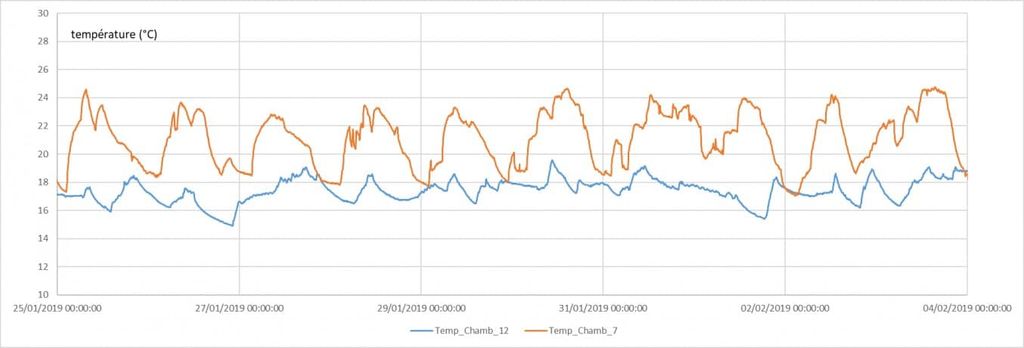
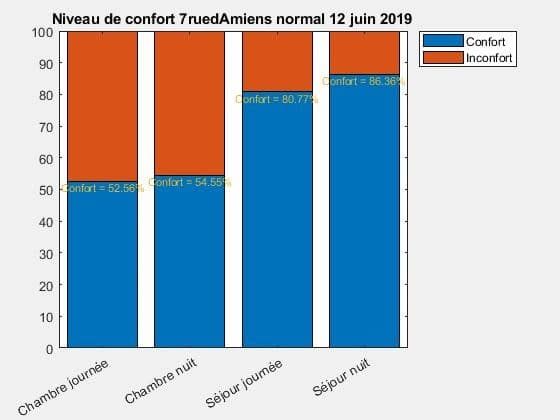
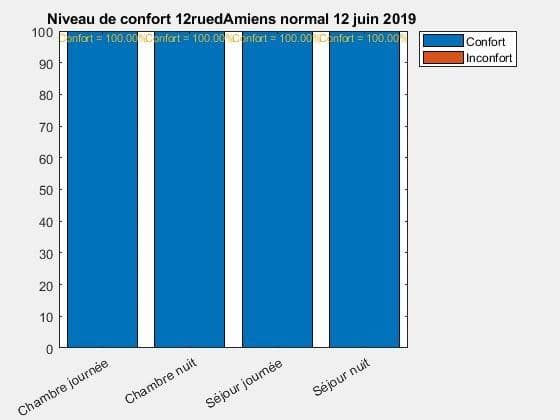
Qui l’utilise aujourd’hui ?
Même si la France est le premier producteur de chanvre en Europe, avec une concentration forte dans le département de l’Aube, l’usage du béton de chanvre se développe mais n’est pas encore très répandu. L’expérimentation de Maisons & Cités à Pecquencourt fait donc figure de pionnière, et son dimensionnement ambitieux pourrait bien changer la donne pour ce matériau innovant. Elle est conduite en 4 phases :
• En 2015, rénovation de la Maison de l’ingénieur et premiers tests de plusieurs éco-matériaux
• De 2017 à 2020, réhabilitation de 3 lots de 2 logements miniers, toujours avec plusieurs éco-matériaux, puis choix du béton de chanvre pour l’isolation dans la poursuite du programme
• De 2021 à 2024, réhabilitation de 50 logements (20 en blocs de béton de chanvre et 30 en projeté) et poursuite des mesures de performances comparatives du matériau, toujours avec le soutien financier des Pouvoirs publics et l’accompagnement technique de CD2E, une équipe d’experts du bâtiment durable
• Dès 2023, début du déploiement avec 65 logements complémentaires isolés à Pecquencourt, 135 autres dans les communes alentour, puis une moyenne de 1 000 logements rénovés par an.



Et demain, est-ce que son usage promet de se développer ?
Oui, et c’est tout l’intérêt de l’action de Maisons & Cités. En parallèle de l’expérimentation technique, le bailleur travaille activement à la constitution d’une filière de production et d’utilisation du chanvre dans les Hauts-de-France, depuis la culture de la plante jusqu’à la création de formations et d’outils dédiés aux professionnels du bâtiment. Pourquoi ? afin de favoriser le développement local, de sécuriser l’approvisionnement pour de futurs chantiers et, surtout, de réduire considérablement les coûts en réussissant à « massifier » la production et l’usage du béton de chanvre.
À l’issue de la dernière phase d’expérimentation à Pecquencourt, et selon les résultats obtenus sur le développement de la filière, Maisons & Cités décidera de la poursuite de l’opération sur 1 000 à 2 000 logements dans les cinq prochaines années, des recherches sur d’autres produits innovants à base de chanvre et de l’intégration du béton de chanvre dans les projets de construction neuve.
Sources
Rencontre avec Franck Mac Farlane, responsable Recherche et Expertise chez Maisons & Cités, novembre 2022
Dossier de presse du Programme Hauts de chanvre édité par Maisons & Cités en novembre 201
Données de la filière chanvre en France : interchanvre.org
Atouts du béton de chanvre : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine et Marne, caue77.fr

Violaine Paton, directrice adjointe en charge du pôle aménagement à la direction des grands projets du groupe CDC Habitat, revient sur les enjeux en matière de sobriété foncière et présente un projet exemplaire sur le plan du recyclage foncier : Parcs en Scène, situé sur les communes de Thiais et Orly.
Ecoutez l’interview :
Retranscription
Dans un contexte marqué par l’accélération du dérèglement climatique et la rareté des ressources naturelles, la sobriété est plus que jamais une priorité. La sobriété énergétique bien sûr, mais aussi la sobriété en matière d’aménagement du territoire et de gestion des ressources. Nous vous proposons dans cet épisode d’en découvrir plusieurs solutions concrètes.
Violaine Paton, bonjour. Vous êtes directrice adjointe en charge du pôle aménagement, à la direction des grands projets de CDC Habitat, filiale du groupe Caisse des dépôts, filiale immobilière à vocation d’intérêt général avec plus de 531 000 logements.
Première question, c’est quoi la sobriété foncière ?

VP : La sobriété foncière, c’est éviter d’utiliser du foncier, notamment du foncier issu de terres agricoles ou naturelles pour développer les activités et l’urbanisme en lien avec les besoins de la société et des villes. Donc, c’est en lien aussi avec l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, le ZAN, qui a pour objectif à 2050 de réduire le rythme d’artificialisation et de consommation des terres agricoles mais également de préserver la biodiversité, qui sont autant de vecteurs pour se protéger vis-à-vis du changement climatique, puisque tout ce qui est biodiversité, nature et nature en ville, permettent quand même de limiter les évolutions brutales du climat et donc cela participe aux mesures contre la crise climatique.
Qu’est-ce qu’on peut prendre comme mesure quand on est une commune, dans ces stratégies de sobriété foncière ?
VP : Il y a bien sûr le fait de ne pas forcément lotir de nouvelles terres agricoles ou naturelles, mais il y a surtout le fait de renouveler la ville sur la ville, c’est à dire de de transformer, de redynamiser des secteurs déjà urbanisés comme des zones de friches industrielles ou d’activités peu denses, afin de créer de nouveaux quartiers, de transformer ces territoires, après bien sûr des mesures de démolition, dépollution, renaturation et dans le cadre de projets d’aménagement d’ensemble, afin de concevoir ces nouveaux quartiers, mais également leurs nouveaux équipements et tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des futurs habitants.
Vous travaillez sur de nombreux projets. Vous devez, j’imagine, mettre en place des démarches partenariales avec les élus ?
Oui, effectivement, CDC Habitat travaille toujours en partenariat, en partenariat avec les élus et toutes les collectivités territoriales. Ce sont les communes, ce sont également les établissements publics, les établissements publics fonciers, les collectivités type EPCI. Mais ce sont également des partenariats avec des promoteurs, avec des opérateurs immobiliers privés avec qui on développe les opérations. Et puis ce sont également des recherches de foncier à faire muter, au niveau de grands propriétaires fonciers qui peuvent être la SNCF ou de grands acteurs industriels.
Une de vos opérations emblématiques, c’est celle de Parc en Scène sur les communes de Thiais et Orly, dans le Val-de-Marne en banlieue parisienne. Une partie d’une zone logistique va devenir un lieu de vie ouvert « vers » et accueillant, c’est bien cela ?
C’est tout à fait cela. Il s’agit d’un grand projet d’aménagement sur lequel on a été lauréat dans le cadre d’un groupement d’opérateurs avec Linkcity, Sogeprom, Bouygues immobilier et CDC Habitat, lors de la consultation Inventons la Métropole du Grand Paris en 2017. Il s’agit d’un projet d’aménagement sur lequel CDC Habitat et Linkcity sont co-aménageurs et co-promoteurs et demain CDC Habitat sera investisseur d’une partie des logements. On est sur la transformation d’une zone logistique de l’ordre de 14 hectares sur lequel on va constituer un nouveau quartier de ville sur les communes d’Orly et de Thiais, en amenant des nouveaux logements… Il y aura près de 3 000 logements dont environ 1 000 gérés par CDC Habitat : du logement social, du libre, des résidences gérées, de l’hôtellerie… et nous aurons également tous les services qui vont accompagner le cadre de vie de ces nouveaux habitants, un peu de tertiaire, un peu d’activité et un grand équipement métropolitain qui s’appelle la Scène Digitale qui sera une arène dédiée au e-sport et au cluster numérique.
Le projet s’appelle Parc en Scènes parce qu’on vient surtout créer deux grands parcs qui vont renaturer et desimperméabiliser le secteur de 8 hectares afin de ramener de la nature en ville, des îlots de fraîcheur et également de la biodiversité.
C’est une belle reconversion qui peut évidemment donner des idées…
Oui, c’est vrai que c’est très inspirant ces grands projets, cela permet de penser dès leur conception, à la fois la place des habitants mais également la place de la nature en ville et de davantage de l’intégrer en vue de préserver l’avenir et l’environnement.


Le groupe CDC Habitat a développé son Plan d’Adaptation au Changement Climatique afin de prendre en compte les risques climatiques actuels et futurs, à l’horizon 2050, dans la gestion de son patrimoine immobilier.
Ce plan s’appuie sur :
- une cartographie d’exposition et de vulnérabilité du patrimoine face aux aléas climatiques actuels et à venir
- un outil de Diagnostic de Performance de la Résilience (DPR) des bâtiments
- un catalogue de préconisations associées
Cartographie d’exposition et de vulnérabilité du patrimoine face aux aléas climatiques actuels et à venir
Le Diagnostic de Performance Résilience (DPR)
Le Diagnostic de Performance Résilience (DPR) permet de mesurer la vulnérabilité d’un ensemble immobilier aux aléas climatiques actuels et à venir : inondations, tempêtes, sécheresses, fortes chaleurs, mouvements de terrains, etc. et répond ainsi à plusieurs enjeux :
- la sécurité de nos locataires – nous logeons aujourd’hui plus d’un million de personnes ;
- le confort de nos logements et donc leur attractivité et commercialisation ;
- l’équilibre financier dans la gestion de notre patrimoine : cela coûte plus cher de réparer ;
- et enfin l’image du Groupe, filiale de la Caisse des Dépôts, qui se doit d’être exemplaire.
Le DPR est réalisé à l’échelle de l’ensemble immobilier. Plusieurs critères peuvent déclencher sa réalisation :
- Un projet de rénovation ;
- Un ensemble immobilier avec une criticité (exposition et vulnérabilité) élevée à horizon 2050 ;
- Des désordres observés par les équipes de proximité ;
- Les besoins exprimés par les parties prenantes, par exemple les collectivités.
Il nous permet de répondre aux questions suivantes :
- Est-ce que l’ensemble immobilier existant – ou en projet – est vulnérable aux aléas climatiques actuels et futurs ? Quel est le niveau de résilience actuel (étiquette allant de A Résilient à G Vulnérable) ?
- Quels travaux ou actions de maintenance seraient à prévoir ?
- Quelles préconisations générales seraient à intégrer dans nos référentiels de construction (MOI et VEFA) ?
Quelle méthodologie mise en œuvre pour réaliser un diagnostic ?
Cet outil est amené à être utilisé en trois phases :
- La première phase BUREAU consiste à réaliser un pré-diagnostic de vulnérabilité à partir d’une analyse documentaire fine du bâtiment ou du projet (DOE, Plans, historique de l’immeuble en termes de travaux, d’évènements climatiques passés, de désordres, etc.). Des premières préconisations peuvent être mises en évidence.
- Vient ensuite la VISITE de site réalisée sur le bâtiment, sa parcelle et son environnement proche (parcelles alentours et accès). Le BET identifie lot par lot l’état apparent des éléments et les éventuels désordres et s’entretient avec l’agence pour avoir l’historique de l’immeuble et mieux connaitre sa gestion.
- Enfin la phase POST-VISITE permet d’obtenir le score de résilience du bâtiment. Le BET met ici en perspective ses observations avec les évolutions du climat 2050, sélectionne les préconisations les plus adaptées et les chiffres. Pour chaque préconisation apparait alors son impact sur la résilience (moyen, fort, très fort).
Quels sont, pour CDC Habitat, les bénéfices associés au déploiement de l’outil DPR ?
Le déploiement des Diagnostics de Performance Résilience pourra alimenter les arbitrages des travaux futurs et donc les Plans Moyen Terme dans l’objectif d’améliorer la résilience des ensembles immobiliers les plus vulnérables. Il s’agit d’embarquer des travaux d’adaptation dans les projets de réhabilitation mais aussi de concevoir des bâtiments neufs anticipant les dégâts à venir.

Alors que la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées s’est achevée, CDC Habitat vous propose de découvrir le témoignage d’Elise Lefevre, responsable ressources humaines à la direction Ile-de-France, dont le handicap invisible a été reconnu en 2020. Pour nous, elle a accepté de revenir sur son expérience, sa vision du handicap et la façon dont nous pouvons collectivement lutter contre les stéréotypes. Rencontre.
Elise, pouvez-vous présenter votre parcours au sein du groupe CDC Habitat ?
Je suis arrivée dans le Groupe en 2015, au sein d’Adoma où j’occupais un poste de RRH. J’ai ensuite évolué dans le groupe CDC Habitat toujours en tant que RRH. Poste que j’occupe actuellement au sein de la direction Ile-de-France où je manage une équipe RH de trois collaborateurs.
Vous êtes en situation de handicap et vous avez accepté de témoigner sur votre situation personnelle, pourquoi ce choix ?
Parce qu’il est primordial de communiquer sur ce sujet, afin qu’il ne soit pas tabou au sein de l’entreprise ; et d’autant plus lorsqu’il s’agit de handicap invisible, ce qui est mon cas. Les personnes concernées par ce type de handicap ont tendance à s’en accommoder, à compenser et donc à renoncer à le déclarer. C’est important pour moi de partager mon expérience et ainsi contribuer à normaliser le handicap.
Votre handicap a nécessité l’adaptation de votre poste de travail, expliquez-nous comment cela s’est passé, comment le Groupe vous-a-t-il accompagné ?
En 2020, à la suite de la reconnaissance de mon handicap, j’ai bénéficié d’un aménagement pour mon poste de travail : au bureau avec du mobilier adapté, mais également à domicile où à titre médical, je télétravaille deux jours par semaine avec un matériel adapté. L’accompagnement a été fluide, ma référente RH et mon responsable hiérarchique ont pris le temps d’écouter mes besoins. J’ai pu échanger avec le médecin du travail et les aménagements nécessaires ont été mis en place pour tenir compte de ma propre situation.
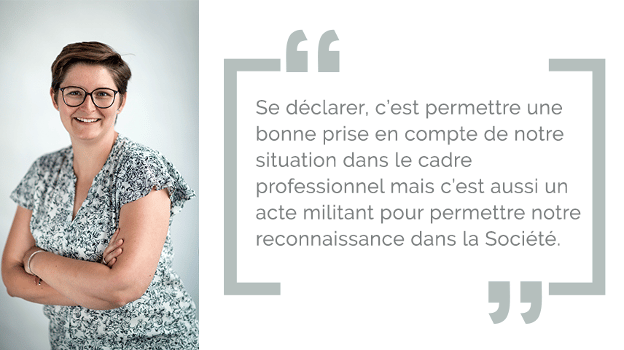
En tant que RRH, vous êtes en charge du recrutement de collaborateurs, dont certains en situation de handicap, votre situation personnelle enrichit-elle votre façon d’appréhender ces candidatures ?
Je peux en effet recevoir, recruter des personnes en situation de handicap, mais je suis surtout confrontée à des situations de collaborateurs qui font face à des accidents de la vie, ayant des conséquences sur leur vie professionnelle. Au regard de ma situation, je dispose d’une sensibilité particulière qui me permet d’être en capacité de désamorcer les a priori, de lever les craintes du candidat/du collaborateur, notamment sur la politique handicap du Groupe, sa vision et la façon dont les situations sont traitées. Mon expérience facilite l’appréhension des situations.
Et quel(s) conseil(s) souhaiteriez-vous adresser aux équipes en charge des recrutements ou en charge de l’accueil des professionnels en situation de handicap ?
Mes collègues en charge du recrutement, sont déjà bien sensibilisés aux différentes situations de handicap et lorsque c’est le cas, ils le font toujours avec beaucoup de bienveillance. L’accord Handicap signé le 15/06/21 au sein du Groupe permet d’être davantage à l’aise dans l’accompagnement des collaborateurs en situation de handicap , c’est un véritable levier.
S’agissant des équipes qui intègrent et managent des personnes en situation de handicap, les deux principaux conseils à transmettre sont de rester à l’écoute et de disposer d’une ouverture d’esprit. En cas de besoin, les managers peuvent solliciter les RRH pour les accompagner et répondre à leurs interrogations et celles de leur équipe.
Et selon vous, comment pouvons-nous collectivement déconstruire les stéréotypes liés au handicap ?
A mon sens, cela passe par la formation, la sensibilisation régulière des équipes et notamment par des exercices de mises en situation. Ce genre d’exercice permet une véritable prise de conscience des situations, c’est très instructif, et cela permet de déconstruire plus facilement et rapidement les idées préconçues.
Pour terminer Elise, si vous aviez un message à adresser à des personnes en situation de handicap qui rencontrent des freins à se déclarer en entreprise ou à candidater à certains postes, quel serait-il ?
Les équipes RH veillent à la bonne prise en compte de la situation des collaborateurs. Se déclarer, c’est permettre une bonne prise en compte de notre situation dans le cadre professionnel, mais c’est aussi un acte militant pour permettre notre reconnaissance dans la Société.








