
Présent dans 13 quartiers prioritaires avec 2 550 logements sur les 4 régions administratives concernées, CDC Habitat Grand Ouest est signataire des contrats de ville 2024-2030 et agit en partenariat avec les collectivités et l’État pour améliorer la qualité de vie des habitants. L’été 2025 a été l’occasion d’organiser plusieurs animations conviviales, destinées à renforcer le lien social et à offrir aux familles, et en particulier aux enfants, des moments festifs et fédérateurs.
Fête de l’écocitoyenneté
À Rouen, dans le quartier Hauts de Rouen Grand Mare c’est sous le thème de l’écocitoyenneté que s’est tenue le 21 juin, une grande fête invitant près de 300 familles. Piloté par CDC Habitat et l’APRE, et organisé en lien avec de nombreux acteurs du quartier, l’événement a permis d’inaugurer un jardin partagé avec l’association On va semer et de proposer divers ateliers sur les écogestes, animés par le SMEDAR. Les enfants ont également profité d’activités artistiques et ludiques, telles que la création de jeux au sol avec le graffeur JIPE ou les structures gonflables. La radio locale HDR a accompagné la journée jusqu’au soir, qui s’est conclu par un repas partagé organisé par l’association Fraternités Bleues.

Fête de l’été
À Nantes et Saint-Herblain, dans le quartier Bellevue, la « Fête de l’été » , organisée le 7 juillet, a rassemblé les locataires autour de la place Mendès France. Cet événement marquait la fin d’un vaste chantier de réhabilitation, mené par CDC Habitat pendant plus de six ans et concernant 260 logements. Il a permis de remercier les habitants pour leur patience et leur confiance tout au long des travaux. Jeux gonflables, stands ludiques et goûters ont animé cette journée placée sous le signe de la convivialité, en présence des locataires, de nombreux enfants, des équipes CDC Habitat ainsi que des représentants de l’État, des collectivités et de Nantes Métropole.

Ferme urbaine
Au Mans, dans le quartier Ronceray Glonnière Vauguyon, la ferme urbaine de la résidence Daumier a été le théâtre de nombreuses animations estivales.
Depuis plus de cinq ans, l’association Jardin du Vivant y propose des activités tout au long de l’année. Cet été, cinq rendez-vous ont rythmé la saison : ateliers de jardinage, ateliers culinaires, sensibilisation autour des abeilles et découverte des plantes adventices.

Repair café
À Joué-lès-Tours, dans le quartier de la Rabière, la Régie de quartier, avec le soutien de CDC Habitat, accompagne les locataires dans l’entretien de leur logement.
Des repair cafés sont régulièrement organisés pour leur permettre de réparer leurs appareils électroménagers. En complément, un service d’aide au bricolage à domicile est proposé pour les petits travaux du quotidien. Une initiative très appréciée par les habitants !

Terrain d’aventure
À Saint-Jean-de-Braye, dans le quartier Pont Bordeau, un terrain d’aventure a accueilli cet été les enfants pour la cinquième année consécutive.
Porté en partenariat avec l’ASCA (Association socioculturelle abraysienne) et les CEMÉA et avec le soutien de CDC Habitat, ce lieu unique invite les plus jeunes à construire cabanes et abris à partir de matériaux de récupération, laissant libre cours à leur imagination. Encadrées par des professionnels, ces activités deviennent de véritables espaces d’échange, de créativité et de découverte.
Animations sur la gestion des déchets
À Hérouville-Saint-Clair, dans le quartier Haute Folie, la sensibilisation à la gestion des déchets — et en particulier aux encombrants — se fait de manière ludique et participative.
En partenariat avec la Boutique Habitat et l’École de la Deuxième Chance, un stand installé sur le marché le 24 septembre dernier a permis d’échanger directement avec les habitants. L’objectif : mieux comprendre leurs pratiques et leurs besoins, tout en leur rappelant les services disponibles pour une gestion plus efficace des déchets. Une démarche qui contribue à améliorer la qualité de vie et la tranquillité résidentielle.

Ces rendez-vous estivaux témoignent de l’engagement de CDC Habitat à favoriser le vivre-ensemble et à contribuer activement à la dynamique de ces quartiers en soutenant la participation des habitants et le développement du lien social.

Défini pour 4 ans, le Plan de Concertation Locative (PCL) est l’occasion de renforcer la relation avec les instances de représentation des locataires.
Dans sa volonté d’améliorer en permanence les conditions d’habitat au sein de son patrimoine, CDC Habitat a toujours misé sur la qualité des relations avec les associations de locataires pour rester en contact avec les attentes du terrain. La concertation locative joue ainsi un rôle majeur dans le quotidien des équipes des 46 agences de proximité de CDC Habitat.

« Une bonne gestion locative passe forcément par des échanges réguliers et constructifs avec les locataires et leurs représentants », rappelle Hélène Coustillières, responsable de la Concertation Locative Groupe chez CDC Habitat. « Si la loi fixe un cadre minimal pour les échanges avec les instances représentatives, CDC Habitat met un point d’honneur à aller encore plus loin, avec plusieurs rendez-vous et moments-clefs formalisés dans notre plan de concertation locative ».
Des conseils qui structurent la relation
Renouvelé tous les 4 ans, celui-ci s’appuie notamment sur les CCLC, les Conseils de Concertation Locative Centraux. Instaurés par la loi SRU en 2000, ces conseils sont un lieu privilégié de dialogue et d’échange entre le bailleur et les associations de locataires où sont abordés tous les grands sujets – qu’il s’agisse de la gestion quotidienne du parc, les projets d’amélioration, l’évolution de la législation ou plus largement la stratégie de l’entreprise.
« Nous sommes tenus d’organiser deux conseils centraux chaque année pour notre patrimoine social, mais nous avons décidé d’étendre cette démarche à notre parc intermédiaire et abordable qui représente quand même un tiers du patrimoine géré, soit plus de 100 000 logements », reprend Hélène Coustillières. « A chaque fois, l’ordre du jour est co-construit avec les confédérations, afin de coller aux mieux à leurs attentes ».
En parallèle de ces CCLC organisés au siège social de CDC Habitat à Paris, chaque agence est tenue d’organiser un conseil de concertation par an avec les instances locales. Ces déclinaisons, les CCLL (Conseils de Concertation Locative Locaux), sont l’occasion de revenir sur les sujets nationaux mais surtout de rentrer dans le détail de la gestion de terrain, avec des présentations d’indicateurs, un planning des projets de travaux à venir ou des retours d’expérience sur les initiatives portées localement.
« Ce lien entre nos agences et les confédérations locales est extrêmement précieux, et c’est pourquoi nous avons décidé d’organiser deux CCLL par an et par agence au lieu d’un seul comme fixé par la loi », précise Hélène Coustillières. « Il y a toujours beaucoup de sujets à aborder pendant ces réunions, dont certains qui peuvent être sources de questions comme le traitement des charges locatives par exemple, nous avons donc estimé qu’il ne pouvait être que bénéfique de nous voir plus souvent ».
Des commissions thématiques pour rentrer dans le fond des dossiers
Si les conseils locaux comme nationaux permettent déjà d’aborder de nombreux sujets, CDC Habitat organise également chaque année des commissions afin de prendre le temps de rentrer dans le détail de certaines thématiques comme la politique d’attribution des logements, l’accompagnement du parcours résidentiel ou l’évolution des charges.
Parfois, ces commissions thématiques peuvent être l’occasion d’organiser des visites de patrimoine, comme ce fut le cas en janvier dernier où une dizaine d’acteurs nationaux ont été invités à découvrir le Village des athlètes en compagnie des équipes de l’agence de la Plaine Saint-Denis. « Cette visite a été l’occasion pour nous de présenter la manière dont nous abordons l’aménagement d’un tel site, l’approche environnementale, les techniques utilisées, ou encore la conception de nos logements sociaux et intermédiaires », détaille Hélène Coustillières.
Des échanges plus fluides
A mi-chemin, le PCL 2023-2026 de CDC Habitat semble en bonne voie de remplir ses objectifs. Les évolutions en matière de fréquence et d’organisation des rendez-vous ont trouvé un écho plutôt favorable auprès des instances nationales comme locales, et les agences de proximité continuent de s’approprier ces formats qui permettent de fluidifier les échanges.
« Notre approche de la concertation repose à la fois sur la transparence, le dialogue et sur une volonté d’écoute », conclut Hélène Coustillières. « Nous ne sommes pas dans une approche verticale mais bien horizontale, qui vise à désamorcer des situations complexes, notamment au niveau local. Dans un contexte global tendu, il est important de savoir avancer de manière constructive ».

Entre hausse du coût du foncier et entrée en vigueur du ZAN, de plus en plus de collectivités invitent les bailleurs à réfléchir sur la possibilité de mener des opérations de densification de leur patrimoine – notamment en surélévation.
Exemples dans le sud-ouest.
Comment continuer à renforcer l’offre de logements en ville sans empiéter sur les terrains existants ? C’est l’une des questions qui s’imposent aux collectivités avec la mise en place de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) à l’horizon 2050, qui vise à lutter contre la bétonisation et à préserver un maximum d’espaces naturels en France. Ajoutée à la hausse du coût du foncier dans de nombreuses métropoles, cette donnée pousse de plus en plus d’acteurs à se pencher sur la question de la densification.
« L’idée de ‘construire la ville sur la ville’ n’est pas nouvelle en soi mais il y a clairement une réflexion qui s’accélère du côté des collectivités, notamment celles où le marché est extrêmement tendu », confirme Laetitia Lateste, directrice du développement de CDC Habitat Sud-Ouest.
La surélévation, une option de plus en plus envisagée
C’est le cas notamment sur la Métropole de Bordeaux où un appel à projets a été lancé en vue de financer la réalisation d’études de préfaisabilité par les bailleurs afin d’identifier les possibilités de densification de leur patrimoine. CDC Habitat s’est prêté au jeu et s’est associé à UpFactor, spécialiste de la surélévation, pour mener un travail sur 10 des 24 résidences gérées par le Groupe sur ce territoire.
« L’étude nous a permis d’avoir un panorama des possibilités d’évolution, et d’identifier notamment un premier site sur Le Bouscat qui pourrait bénéficier d’une opération de surélévation », explique Raphaël Fourmond, directeur du patrimoine de CDC Habitat Sud-Ouest. « Ce type d’intervention impose le respect de nombreuses conditions techniques et réglementaires, notamment en matière de solidité des fondations, de reprise de charge et contraintes vis-à-vis des réglementations locales d’urbanisme ».
Les surélévations étant faites dans la plupart des cas en bois pour des raisons de poids, les questions de sécurité incendie doivent également être prises en considération, et des études géotechniques doivent être menées en amont pour connaître l’état du sol – une spécialité que maîtrise parfaitement UpFactor.


Une approche plus large de la densification
Ce ne sera pas la première fois que CDC Habitat réalisera des opérations de densification de son patrimoine dans le sud-ouest. De Toulouse à Lacanau, de Saint-Juéry à Talence en passant par la Benauge, plusieurs projets ont été menés ces dernières années pour renforcer l’offre locative – et pas uniquement grâce à la surélévation.
« La surélévation est évidemment la première solution qui vient à l’esprit, mais elle reste très contrainte techniquement parlant, et se limite le plus souvent à deux niveaux maximum », précise Gilles Labarthe, directeur de la Maîtrise d’ouvrage pour CDC Habitat Sud-Ouest. « Il existe d’autres possibilités comme un travail sur l’épaisseur du bâti existant pour rajouter des pièces aux appartements, ou la construction de bâtiments sur des terrains déjà bétonnés – par exemple sur des dalles de parking de certaines résidences ».
A chaque fois, ces opérations doivent être adaptées sur-mesure, en tenant compte du PLU, de l’équilibre financier de l’opération ou encore des réticences, souvent nombreuses, des riverains. « Pour concrétiser le ZAN, il faut un réel engagement des collectivités qui vont porter ces projets politiquement et faciliter leur acceptation par les habitants », conclut Laetitia Lateste. « Pour l’instant, la densification reste l’exception, mais sur des fonciers très chers et des territoires très demandés, c’est un outil qui mérite qu’on s’y attarde ».

Dans le cadre de l’axe « Environnemental » de son Projet de Territoires, CDC Habitat renforce ses actions en faveur de la protection de la biodiversité en Île-de-France, notamment en systématisant le recours à la gestion différenciée des espaces verts sur son patrimoine.
Avec près de 24% du territoire recouvert d’espaces verts, l’Île-de-France est loin d’être le désert de béton que l’on imagine parfois. Et si la situation est évidemment contrastée en fonction des villes et des zones, les possibilités d’agir pour préserver la biodiversité sont assez nombreuses, notamment pour les bailleurs comme CDC Habitat qui ont fait le choix d’avoir une politique proactive sur cette question.
« Nous avons environ 1000 résidences avec des espaces verts sur notre patrimoine francilien, pour un total de près de 300 hectares », explique Delphine Swysen, responsable pilotage urbain chez CDC Habitat. « Cela nous fait un bon levier pour soutenir la biodiversité en ville qui est plus riche qu’on ne le penserait ».
Des contrats d’entretien adaptés
Parmi les différents leviers à sa disposition, CDC Habitat Île-de-France a notamment choisi de profiter du renouvellement de ses contrats d’entretien des espaces verts pour mettre l’accent sur la gestion différenciée. « Cette technique vise à entretenir moins souvent mais mieux les espaces verts et en revenant à des techniques de jardinage plus traditionnelles, étant entendu que désormais les produits chimiques sont interdits par la loi », précise Alexandre Dias, référent biodiversité au sein de la Direction Technique & Maintenance de CDC Habitat Île-de-France.
Cette approche permet à la végétation de se développer dans la durée, afin d’offrir nourriture et habitat à la faune. Mais si la technique a largement fait ses preuves, elle demande néanmoins une certaine acculturation, que ce soit de la part des prestataires, des locataires ou de certaines collectivités. « La gestion différenciée nécessite de ne pas tailler la pelouse partout ni aussi fréquemment, de laisser ponctuellement la nature pousser de manière presque sauvage… », souligne Elodie Lachaud, cheffe de projet chez Grand Paris Habitat. « C’est assez loin des standards esthétiques habituels et cela peut donc surprendre au début, d’où la nécessité de faire de la pédagogie sur le terrain ».

Intégrer la biodiversité à tous les échelons
Parallèlement, CDC Habitat continue d’intégrer la question de la biodiversité à l’ensemble de son activité, en lui faisant notamment une place dans ses projets de résidentialisation ou de réhabilitation. Plusieurs « mini-projets » sont également portés localement par les agences pour améliorer le quotidien des autres résidences– en renaturant certains sols, en végétalisant les grillages, en installant des nichoirs ou encore en plantant de nouveaux arbres.
« Notre but est d’améliorer le cadre de vie des locataires, sans attendre uniquement les gros projets d’investissement pour agir », conclut Elodie Lachaud. « De petites actions bien pensées peuvent avoir un effet réel sur le vivant mais aussi sur le confort d’été ou l’infiltration des eaux pluviales ».
résidences de CDC Habitat en Île-de-France ont des espaces verts en gestion directe
hectares à gérer de manière différenciée, soit 1/3 du Bois de Vincennes

Le groupe CDC Habitat s’est engagé en faveur d’un ambitieux plan de préservation de la biodiversité au niveau national. En région, les initiatives concrètes se multiplient. Exemple dans le sud-ouest avec une initiative portée conjointement avec Toulouse Métropole.
Un accord pour agir collectivement
Et si on passait enfin des paroles aux actes en matière de protection de l’environnement ? C’est le défi relevé par Toulouse Métropole et CDC Habitat, qui ont signé un « contrat d’engagement » sur 5 ans. L’objectif : identifier des actions concrètes pour engager une vraie mutation environnementale – que ce soit en matière de construction, de réhabilitation, de développement ou encore de gestion technique.
« Cela fait un moment que CDC Habitat porte une réflexion globale sur ces questions au niveau de son patrimoine, notamment dans le sud-ouest où nous sommes en première ligne face aux changements climatiques », souligne Laurent Cazaban, directeur du patrimoine adjoint chez CDC Habitat Sud-Ouest. « Nous avons donc accueilli avec beaucoup d’enthousiasme ce contrat d’engagement qui est une occasion de concrétiser notre approche sur un territoire donné, et d’y imprimer notre marque de fabrique – avec notamment un volet dédié à la biodiversité, un sujet sur lequel nous avons été le seul bailleur à nous engager ».
Un diagnostic pour identifier les potentiels d’action
Soucieux d’œuvrer pour la régénération d’espaces de biodiversité en milieu urbain, CDC Habitat a donc lancé un diagnostic sur dix ensembles immobiliers lui appartenant à Toulouse, Tournefeuille et L’Union (6 en propre et 4 de sa filiale spécialisée dans l’hébergement et le logement accompagné, Adoma). A partir des données collectées, un certain nombre d’actions ont été identifiées afin d’améliorer l’existant – allant de la gestion des espèces exotiques envahissantes jusqu’à la désimperméabilisation de certains espaces enrobés en passant par l’installation de nichoirs ou le recours à une gestion écologique et différenciée des espaces verts.
« Les résultats de l’étude ont été présentés début septembre aux équipes de Toulouse Métropole avec qui nous avons pu acter les grandes lignes du plan d’action et le démarrage opérationnel des travaux », précise Séverine Durrieu, directrice de l’agence Toulouse Garonne. « Cette approche plaît car elle va aussi participer à créer des îlots de fraicheur dont la ville va avoir de plus en plus besoin dans les années qui viennent ».

Création d’un outil d’aide à la décision
Loin de s’arrêter à ces 10 sites, les équipes ont également poussé la réflexion jusqu’à créer un « arbre à décision » mettant en lumière les différents leviers d’actions possibles en matière de végétalisation des sites et de protection de la biodiversité. Cet outil d’aide à la décision permettra notamment aux équipes opérationnelles d’intégrer certaines démarches dans la conception des programmes neufs ou des futurs projets de réhabilitation du patrimoine.
CDC Biodiversité, un expert de la mutation des territoires
Pour mener à bien les diagnostics des différents ensembles immobiliers, l’agence de Toulouse et les équipes du siège ont pu compter sur l’appui de CDC Biodiversité qui, depuis 2008, accompagne les projets visant à concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. La filiale du Groupe Caisse des Dépôts s’appuie notamment sur une triple expertise écologique, foncière et financière pour concevoir et mettre en œuvre des actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité. Elle accompagne des acteurs publics et privés, pour des actions volontaires, à travers l’intégration des enjeux écologiques dans les projets d’aménagement en milieu urbain (création d’habitats pour la faune, végétalisation, désimperméabilisation, renaturation d’espaces artificialisés) ou réglementaires, à travers l’application de la séquence ERC par exemple.
CDC Biodiversité vient d’ailleurs d’ouvrir des bureaux à Toulouse afin de se rapprocher des acteurs locaux qui se mobilisent pour relever les défis environnementaux actuels.

Avec plus de 1000 logements acquis sur les différents sites ayant servi à accueillir athlètes et journalistes durant l’été 2024, CDC Habitat est désormais engagé dans une course contre la montre pour remettre en état, transformer et commercialiser ce patrimoine très attendu.
Après l’effervescence sportive, place à la transformation urbaine. A Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Île-Saint-Denis et Dugny, les sites ayant accueilli le Village des athlètes et celui des médias s’apprêtent à entamer leur seconde vie avec la transformation et l’adaptation de ces logements temporaires en logements pérennes.
« La particularité du patrimoine que nous avons acquis sur ces sites est d’être réversible et évolutif », confirme Astrid Douguet Le Coz, directrice Adjointe des Programmes VEFA chez Grand Paris Habitat, la structure en charge du développement chez CDC Habitat Île-de-France. « Dès la conception, les programmes ont été pensés à la fois pour l’événement et pour l’après, avec donc des aménagements spécifiques pour la compétition qu’il faut désormais réadapter pour une mise en vente ou en location plus classique ».
Une transformation anticipée
Le programme est d’autant plus conséquent que ce ne sont pas moins de 1139 logements que CDC Habitat a acquis sur les différents sites. Après avoir rempli avec succès leur premier rôle, il est donc désormais temps pour chaque appartement de prendre l’affectation qui lui a été prévue en amont – entre logement locatif étudiant, social, intermédiaire, abordable ou même local commercial.
« Pendant la compétition, les chambres ne disposaient pas de cuisine car les athlètes n’étant pas censés se faire à manger eux-mêmes », reprend Astrid Douguet Le Coz. « Cela permettait d’avoir des T3 avec 3 chambres qu’il s’agit désormais de transformer en T3 plus traditionnels, avec seulement 2 chambres mais aussi un espace cuisine ». La transformation devrait être d’autant plus rapide que les promoteurs avaient anticipé les travaux à venir, avec des arrivées d’eau déjà prêtes, certains carrelages déjà posés, et le plus souvent seulement des cloisons provisoires à déposer – en plus de reprendre les dégradations liées à l’occupation temporaire.



Une nouvelle vie de quartier à inventer
Reste que c’est une course contre la montre qui a démarré pour permettre aux bâtiments d’accueillir leurs nouveaux occupants au plus vite. A Saint-Ouen, la promesse faite par la ville de transformer le Village des athlètes en « quartier résilient et vert » suscite un réel intérêt de la part des habitants mais ceux-ci attendent aussi de voir de quelle manière ce nouveau morceau de ville va pouvoir s’intégrer aux dynamiques locales.
« Les travaux devraient durer entre mars 2025 et janvier 2026 selon les résidences, et nous préparons depuis janvier la mise en exploitation et la commercialisation des différents sites », conclut Astrid Douguet Le Coz. « On sent un intérêt pour ces programmes mais cela reste encore un peu timide, car ce sont des sites où il n’y avait rien auparavant et où tout est à créer. C’est un vrai défi pour l’ensemble des acteurs ».
Retour à la normale pour la résidence Studéfi de Saint-Ouen
Déjà en service avant la manifestation sportive, la résidence Studéfi va pouvoir de nouveau accueillir les étudiants de l’ISAE-Supméca qui avaient quitté le site pour laisser la place aux athlètes. La réversibilité du site, pensée dès la conception, a permis de faciliter le passage de relais avec Paris 2024 qui a géré le site du 1er mars au 30 novembre et avait notamment changé le mobilier et fermé les cuisines pendant toute la durée d’hébergement des athlètes.
En résumé:
Logements acquis par Grand Paris Habitat (dont
540 sur Saint-Ouen, 354 sur Saint-Denis, 90 sur L’Île-Saint-Denis, 155 sur Dugny)
logements sociaux (dont 120 logements étudiants).
logements locatifs intermédiaires
logements locatifs abordables
locaux commerciaux

CDC Habitat a organisé cet été un projet inédit entre Hexagone et outre-mer, afin de permettre à 20 jeunes de se rencontrer et d’échanger autour d’activités sportives et de découvertes du patrimoine.
Le lien entre la ville des Mureaux et la Guyane est ancien et profond. Berceau de la fusée Ariane, la commune des Yvelines entretient en effet des relations privilégiées avec le territoire ultramarin qui accueille le Centre spatial guyanais (CSG) d’où décolle le lanceur civil européen de satellites.
« Ce sont Anne-Sophie Grave, Présidente du Directoire de CDC Habitat, et François Garay, Maire des Mureaux, qui ont en premier évoqué la possibilité de faire le lien entre cette Histoire industrielle et notre patrimoine », explique Isabelle Cosyns, responsable du service de Développement Social et Urbain (DSU) chez CDC Habitat Île-de-France. De cette intuition de départ est née une des opérations les plus originales menées par le Groupe ces dernières années : un séjour de 17 jours qui a permis à 10 jeunes Muriautins et 9 jeunes Guyanais, tous locataires de CDC Habitat, de se rencontrer et de partager activités sportives, visites et moments sportifs.
17 jours d’échanges inoubliables
C’est donc en Guyane que s’est déroulé le 1er volet du voyage du 13 au 21 juillet. Sur place, les jeunes franciliens ont pu découvrir de superbes paysages, dormir dans la jungle, partir à l’aventure sur les Îles du Salut en catamaran et bien sûr aller visiter le CSG. A leurs côtés, les 10 jeunes guyanais leur ont permis de se familiariser rapidement avec les lieux. « Le groupe était encadré sur place par l’IFAS, une association sportive locale, missionnée par les équipes de la SIMKO et la SIMGUY, les filiales guyanaises de CDC Habitat », reprend Isabelle Cosyns.
Si Ariane 6 avait déjà décollé à l’arrivée des jeunes du fait d’une météo favorable, tous ont pu profiter de ce cadre exceptionnel pour faire connaissance et partages des moments exceptionnels avec leurs nouveaux amis, avant de reprendre l’avion direction Paris pour une 2ème semaine placée sous le signe de la compétition sportive qui a réuni le monde entier. Outre des excursions au Château de Versailles ou à la Tour Eiffel, les adolescents ont pu assister au passage de la Flamme aux Mureaux, ainsi qu’aux quarts de finale de skateboard sur le site de la Concorde.




Le fruit d’un travail partenarial formidable
« La ville des Mureaux avait mis à disposition son gymnase pour que tous les jeunes puissent y camper et des bus pour faciliter les déplacements », précise Isabelle Cosyns. Pas question en effet pour les locaux de l’étape de retourner chez eux : le Groupe est resté soudé jusqu’à la fin du séjour. Côté sport et encadrement, c’est l’association sportive UFOLEP78 qui a géré les animations, profitant à la fois des infrastructures de la commune et du département pour un programme alliant accrobranche, kayak, tchoukball et passe à 10.
Une mobilisation de tous les partenaires qui a largement contribué au succès de cette épopée hors norme qui s’est achevée le 30 juillet – non sans quelques larmes au moment de se quitter.
Pour découvrir en image cette aventure, rendez-vous sur la page Instagram @raidytogo__pariscayenne2024
François Garay, Maire des Mureaux
« Notre lien avec Kourou et la Guyane est étroit du fait de la présence sur notre commune d’Ariane Group. C’est une histoire que nous partageons avec les habitants et que nous essayons de faire vivre à travers différents projets, comme cette maquette de la fusée Ariane 5, haute de 12 mètres, qui trône sur un rond-point à l’entrée de la ville et qui a été réalisée par des apprentis et des lycéens de la commune et de la vallée de Seine.
Le projet que nous avons porté avec CDC Habitat avait pour but de permettre à des jeunes qui n’auraient jamais eu l’occasion de se croiser de vivre un échange interculturel assez incroyable, de l’Amazonie au château de Versailles, du site de lancement de Kourou aux rues de Paris et des Mureaux. C’est une expérimentation qui mériterait sans doute d’être généralisée, même à d’autres territoires plus proches, comme les Hauts de France ou le Grand Est. On dit souvent que soit on reste immobile, soit on voyage et on apprend. Je pense que les collectivités et les bailleurs ont un rôle à jouer pour aider les jeunes à sortir de leurs quartiers et à s’ouvrir à d’autres villes et d’autres gens ».

Annoncé en mai 2023, le plan de soutien de CDC Habitat a mobilisé les promoteurs dans le sud-ouest et permis à la direction interrégionale de retenir une centaine d’opérations pour un total de près de 4000 acquisitions en VEFA.
Des acquisitions qui viennent soutenir l’activité locale
L’investissement de 3 milliards d’euros annoncé au printemps 2023 par CDC Habitat pour soutenir la production de logement et le secteur de la construction, confrontés à plusieurs crises simultanées (inflation, hausse du coût des énergies et des matières premières…), a été particulièrement bien accueilli dans le sud-ouest. Plusieurs centaines de projets ont été soumis par les promoteurs aux équipes de la direction interrégionale qui ont étudié plus de 10 000 lots pour en retenir au final 3 835 (sur les 17 000 prévus au niveau national, soit 22%).
Comme l’explique Laetitia Lateste, directrice du développement pour CDC Habitat Sud-Ouest, « nous avons sélectionné des programmes en phase avec nos projets de territoires, avec des critères de sélection particulièrement exigeants en matière d’emplacement et de proximité avec les transports, mais aussi de performances énergétiques – avec a minimum un seuil 2022 voire 2025 de la RE2020 et une certification NF Habitat HQE qui nous donne le gage d’une bonne qualité et d’un bon confort pour les usagers ».
Une mixité assumée et renforcée
Autre exigence fixée par CDC Habitat dans le cadre de son plan de soutien, les projets retenus concernent en moyenne un tiers de logements sociaux (1 189 lots) et deux tiers de logements intermédiaires (2 646 lots). Si la demande reste très élevée sur le parc social, notamment sur les grandes métropoles, CDC Habitat souhaite renforcer la mixité de l’offre au niveau local, en apportant aux collectivités son expertise en matière de construction de logement locatif intermédiaire (LLI).
« Le LLI s’adresse notamment aux jeunes actifs, seuls, en couple ou avec des enfants, mais aussi à une part croissante de travailleurs clefs ou de fonctionnaires – agents des collectivités, du secteur hospitalier, de l’éducation nationale ou militaires », précise Laetitia Lateste, directrice du développement. « Cette offre a donc un rôle réel à jouer pour renforcer le lien emploi/logement et l’attractivité économique des territoires ».
Les signatures de projets ont été l’occasion pour les équipes de la direction interrégionale d’aller à la rencontre de nombreux élus, et d’accélérer le développement sur certains secteurs comme celui des Landes. Par ailleurs, ces acquisitions en VEFA viennent s’ajouter aux projets déjà initiés par CDC Habitat Sud-Ouest : au total, le Groupe livrera entre 8000 et 8750 logements en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine d’ici à 2027.
En résumé :
- 10 079 logements étudiés
- 3 835 logements retenus dont
- 1 189 logements sociaux
- 2 646 logements intermédiaires

Perrine Cantin-Michaud, directrice régionale adjointe en charge des partenariats et de la stratégie patrimoniale au sein de la direction interrégionale AURA, revient sur la manière dont le bailleur se saisit des questions climatiques au quotidien.
CDC Habitat a dévoilé l’an dernier son Plan stratégique climat : quels en sont les fondamentaux ?
Notre volonté est de nous mettre en phase avec la trajectoire nationale visant à limiter la hausse des températures sur la planète à 1,5°C d’ici à 2050. Pour cela, le Groupe s’est notamment fixé comme objectif d’atteindre 110 kWh d’énergie primaire et moins de 15 kg de CO2 par m2 et par an à l’horizon 2030 sur l’ensemble de son patrimoine. C’est un objectif ambitieux mais réaliste que nous déclinons localement en nous appuyant sur un ensemble de leviers opérationnels et sur des partenariats avec les collectivités.
Quels sont les leviers privilégiés en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Notre premier axe de travail est la question de l’adaptation du bâti à cette nouvelle réalité climatique. Pour le patrimoine existant, nous avons notamment fait le choix de traiter 100% de nos étiquettes F et G et 80% de nos étiquettes E avant 2030, en avance sur la stratégie nationale bas carbone. Au-delà de la question du DPE, nous menons des opérations de réhabilitation mais aussi de démolition/reconstruction d’ampleur sur notre patrimoine. Nous en avons 13 actuellement au niveau de la direction interrégionale, avec des objectifs d’amélioration de la performance énergétique pouvant aller jusqu’à 40% comme sur la résidence Arlequin à Grenoble.
Et pour la construction neuve ?
Là aussi nous privilégions une approche vertueuse et « bas carbone » qui passe à la fois par la conception des bâtiments, leur construction et leurs usages. Nous nous efforçons à la fois de réduire notre empreinte et d’améliorer le confort de nos locataires, notamment face aux vagues de chaleur qui se multiplient. Cela va de la végétalisation des façades et des toitures-terrasses au raccordement aux réseaux de chaleur urbain en passant par la solarisation des places de parking ou la mise en place d’ombrières. Nous généralisons aussi le réemploi de matériaux sur nos chantiers, comme à Clermont-Ferrand dans le cadre de la réhabilitation de la résidence des Trioux sur le quartier de la Gauthière.
Comment emmener tout le monde dans cette aventure ?
La sobriété énergétique est l’affaire de tous. Bien sûr en tant que bailleur nous menons des opérations de sensibilisation des locataires aux écogestes, au tri des déchets et à la réduction des consommations d’énergie. Mais nous appliquons la même exigence à nos équipes, avec des incitations aux mobilités douces, qui s’est traduit par l’obtention du label « employeur pro-vélo », par le recours à du mobilier upcyclé dans nos locaux… Nous avons aussi choisi d’intégrer à l’automne prochain la Convention des Entreprises du BTP pour le Climat qui fixe un cadre contraignant pour les entreprises et leurs dirigeants, et vise à accompagner la transformation systémique des acteurs économiques.
Avec les collectivités aussi, la mobilisation se précise…
Nous sommes évidemment aux côtés des territoires pour soutenir la mise en place de politiques ambitieuses. Nous avons par exemple signé avec la Métropole de Lyon une convention partenariale, nous respectons le référentiel Grand Lyon Habitat Durable dans nos opérations et souhaitons nous inscrire dans son plan Nature avec ses aides pour la végétalisation des espaces privés. Nous nous venons également de signer une convention avec Clermont Auvergne Métropole pour accompagner la feuille de route de production de logements à l’horizon 2025 et avons intégré l’Alliance pour la Transition de la Métropole.

Réemploi et recyclage, construction bioclimatique des bâtiment, recours au bois et au béton bas carbone, transport fluvial, etc. Les constructeurs du Village des athlètes ont joué sur tous les leviers pour réduire drastiquement les émissions des bâtiments pendant la phase de construction, mais aussi après. Ils ont ainsi préfiguré la ville bas carbone de 2030, en permettant aux porteurs de solutions innovantes de les déployer et massifier.
Quel était l’objectif fixé aux concepteurs du Village des athlètes ?
L’ambition de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques chargée de construire les ouvrages pérennes des différents sites était exigeante : faire de cette édition 2024 la première alignée sur l’accord de Paris en posant une première étape vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. Les objectifs de décarbonation sont sans précédent : réduire par deux les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à une construction classique. Cet impératif s’applique aussi bien à la phase de construction qu’à celle de l’exploitation des bâtiments. Non seulement les chantiers doivent générer le moins d’émissions possible, mais la conception des bâtiments doit également permettre une réduction drastique de la consommation de chauffage et une climatisation naturelle.
Quels sont les différents leviers utilisés par les constructeurs ?
L’idée est de jouer sur tous les leviers possibles pour parvenir au final à une division par deux des émissions de GES : recyclage et réemploi des matériaux, recours à des matériaux biosourcés et bas carbone, transport fluvial pour limiter les déplacements par camions, conception bioclimatique des bâtiments, etc.
Comment l’objectif de division par deux des GES a-t-il été calculé ?
L’ambition affichée par la Solideo était de diviser par deux les GES… mais par rapport à quoi ? Elle s’est basée sur les standards de 2019 du secteur de la construction et la réglementation thermique en structure béton de l’époque. L’ensemble des dispositifs mis en place ont permis une réduction de 47 % des émissions par rapport à ce standard.
Quels matériaux ont été privilégiés ?
Le bois est le matériau roi de la ville bas carbone. Le parti pris du Village des athlètes a donc été de massifier sa présence, et non de le réserver aux réalisations les plus emblématiques. Son utilisation pour les structures des ouvrages a été rendue quasi systématique pour les bâtiments de moins de 28 mètres de haut. 100 % des bâtiments du Village des athlètes font intervenir du bois en structure et 49 % ont adopté une structure tout en bois.
Par ailleurs 100% du bois utilisé provient de forêts éco-gérées et 30 % des forêts françaises.

De son côté, l’impact du béton a été considérablement réduit grâce à l’utilisation de formules innovantes de béton bas carbone. Le quartier des Belvédères notamment, porté par le groupement Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, Groupama et EDF, a opté pour un mode constructif frugal bois/béton bas carbone. 100 % des bétons préfabriqués pour les prédalles, prémurs et escaliers sont bas carbone.
Quel rôle a joué la Seine ?
La proximité du fleuve a donné des idées à la Solideo : pourquoi ne pas l’utiliser pour limiter les émissions de carbone dues aux va-et-vient des camions transportant matériaux de construction et déblais ?
La circulation de plus de 25 000 camions a ainsi été évitée grâce au transport fluvial. Sachant qu’une tonne transportée par le fleuve produit cinq fois moins de CO2 que le transport routier.
Quels étaient les objectifs de réemploi et de recyclage imposés aux constructeurs ?
Le secteur du bâtiment utilise beaucoup de ressources et produit des déchets. D’où l’importance du réemploi des matériaux ou de leur recyclage (en les transformant), qui sont au cœur de l’économie circulaire.
Les cahiers des charges imposés aux constructeurs par la Solideo ont fixé deux règles… Au moins 10 % des approvisionnements devaient être issus du réemploi, à l’échelle de chaque ouvrage. Par ailleurs, 75% des matériaux provisoires mis en place durant la compétition devaient pouvoir être démontés et réemployés sur place pour les aménagements définitifs ou sur d’autres chantiers. Saint-Gobain a notamment déployé des cloisons démontables en plâtre, dotées des mêmes caractéristiques acoustiques que des cloisons classiques. C’est une première : jamais ce matériau n’a été réemployé à cette échelle.
Au moment de la déconstruction des ouvrages existants, les éviers et équipements électriques seront revendus à des particuliers par le biais d’une plateforme de réemploi. Par ailleurs, les sièges des gradins du centre aquatique olympique ont été fabriqués à partir de plastique recyclé.
De la même manière, le béton issu de la déconstruction a été récupéré et recyclé pour fabriquer les chemins empruntés par les ouvriers sur les chantiers.



Quels sont les bénéfices apportés par la conception bioclimatique des bâtiments ?
Concevoir un immeuble pour limiter sa consommation future en énergies : c’est tout le pari de la conception bioclimatique, généralisée sur l’ensemble du Village des athlètes.
Pour limiter la consommation liée au chauffage l’hiver, les bâtiments bénéficient d’une bonne isolation, offrant une étanchéité à l’air importante. Pour un confort d’été sans recours à la climatisation, les logements sont traversants et disposent de protections solaires permanentes. Plus de 1 200 logements sont dotés d’un plancher chauffant/rafraîchissant qui vise à garantir une régulation thermique optimale. En mode chauffant, ce dispositif assure une température de 19°C. En mode refroidissant, l’eau froide circulant dans les tubes peut faire baisser la température de 5 à 7 degrés l’été.
Le quartier des Quinconces, porté par le groupement Icade, la Caisse des Dépôts, et CDC Habitat, reprend tous les principes de la conception bioclimatique : les logements bénéficient d’une double orientation et un jeu sur les hauteurs de chaque bâtiment maximise l’ensoleillement pour chaque logement. L’été, une forêt fraîche au pied des immeubles permet de faire baisser de plusieurs degrés la température en cas de forte chaleur. Prolongée par des jardins sur les toits, celle-ci contribue à lutter contre les îlots de chaleur.

Qu’est-ce qui est prévu pour limiter la consommation d’énergies fossiles ?
Les énergies renouvelables et locales, ainsi que les énergies de récupération sont privilégiées. Une grande partie des toitures est équipée de panneaux photovoltaïques, une énergie que les bâtiments vont utiliser. La géothermie est également de la partie. Des forages dans la nappe à 80 mètres sous terre font remonter l’eau : les calories sont récupérées au moyen d’un échangeur et valorisées grâce à une pompe à chaleur.
Dans le secteur des Belvédères, le bâtiment tertiaire s’est doté d’un pilotage énergétique innovant, qui associe solaire photovoltaïque, stockage d’électricité et utilisation des batteries de véhicules électriques comme source d’énergie.
Un dernier coup de pouce : la réversibilité des bâtiments
Décarboner l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment, c’est aussi limiter l’impact carbone de ses transformations futures. En mettant l’accent sur la réversibilité des bâtiments, la Solideo a apporté la touche finale à son projet de décarbonation du Village des athlètes. Les logements prévus pour accueillir les sportifs sont conçus dès le départ en mode réversible : des modifications mineures et des jeux de cloisons, sans conséquence sur la structure du bâtiment, leur permettront d’accueillir des familles dans la phase héritage

Ingrid Nappi, professeure titulaire et fondatrice de la Chaire Economie de la transition écologique urbaine (Immobilier, Logement, Architecture, Aménagement) de l’Institut Louis Bachelier.
Face à l’urgence climatique et aux évolutions sociétales et sociales en matière d’habitat et de travail, nous devons réinventer la production de la ville. C’est l’ambition de la Chaire Economie de la transition écologique urbaine (Immobilier, Logement, Architecture, Aménagement) de l’Institut Louis Bachelier qui entend devenir une plate-forme de recherche et d’enseignement pour aider à la décision économique et politique, en matière d’écologie, de vivre ensemble et de travail.
Car comment répondre aux besoins croissants des ménages à se loger et développer une offre immobilière à la fois résidentielle, industrielle et tertiaire (zones commerciales, quartiers d’affaires) tout en accompagnant la transition écologique urbaine ? Comment valoriser économiquement et financièrement les initiatives et les projets à forte utilité écologique ? Comment repenser la chaine de valeur et notamment le rôle économique des nouveaux entrants dans les nouvelles filières de l’immobilier qui se dessinent ? Comment innover et construire autrement, alors que la rareté foncière devient un obstacle majeur pour les maîtres d’ouvrage ? Comment promouvoir la densité et le recyclage du tissu urbain tout en conservant la qualité des espaces de vie ?
Les enjeux de la transition écologique impactent toute la chaîne de valeur de la fabrique de la ville. Le processus de développement des projets doit être révisé pour y intégrer des indicateurs de performances nouveaux (décarbonation, impact social, environnemental…) et la place ainsi que l’apport de chaque professionnel (investisseur, architecte, maître d’ouvrage, entreprise, industriel…) doit évoluer. Pour répondre à cette nouvelle donne, nous devons passer d’une approche en silos à une approche holistique. L’originalité et la pertinence de cette chaire passe par la réunion des trois dimensions essentielles que sont l’économie et la finance, les sciences de l’ingénieur et l’architecture, soit une approche inédite en France.
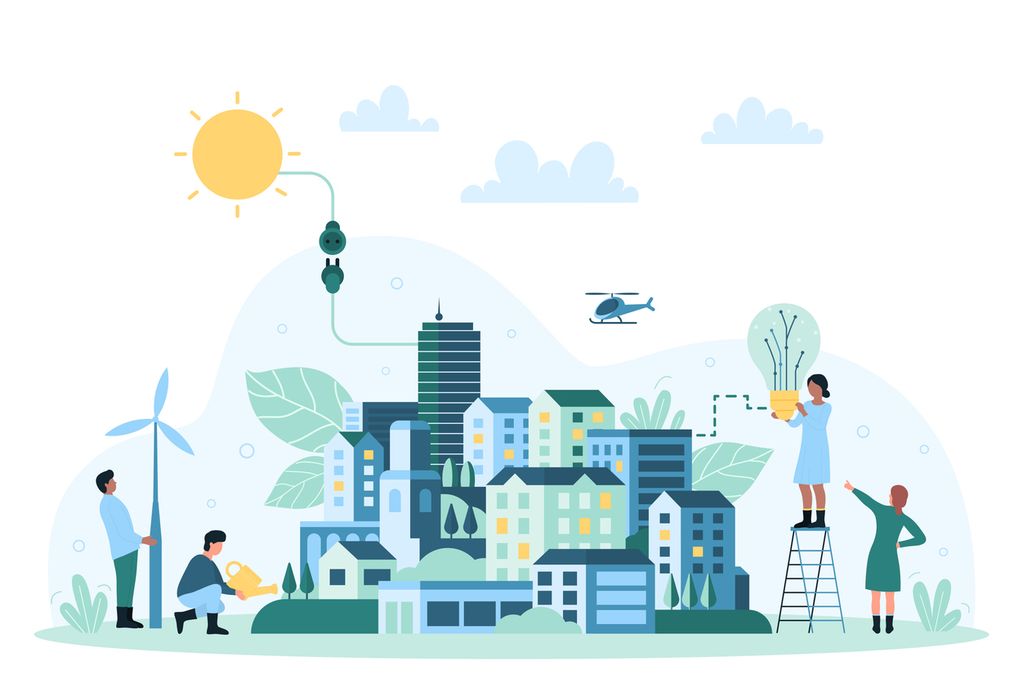
Lancée en 2023, la chaire s’appuie sur un partenariat réunissant la Fondation du risque de l’Institut Louis Bachelier, qui l’héberge parmi 80 autres programmes de recherche, l’École des Ponts ParisTech et l’Ecole Nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Les ministères de la Transition Ecologique et de la Culture soutiennent le projet qui rassemble aussi de nombreux contributeurs et mécènes parmi lesquels CDC Habitat.
La chaire diffusera progressivement tous les savoirs acquis sous la forme de cours, séminaires et conférences, d’outils et de cahiers pédagogiques pour former le plus largement possible. Après quelques mois d’activité, elle vient d’organiser une conférence inaugurale sur le thème « réinvestir l’immeuble résilient » et d’éditer un premier cahier pédagogique dédié. Son comité scientifique transdisciplinaire, composé d’universitaires issus de l’École des Ponts ParisTech et de l’ENSA Paris-Malaquais, mais également d’autres écoles telles que l’école d’urbanisme de Paris ou Centrale Lille, est en train d’élaborer les axes de recherche sur les financements de la transition écologique.

Peut-on réconcilier nature et ville ? Créer une forêt fraîche et sauvage dans un quartier d’habitation, amenée à évoluer selon le tempo de la flore et la faune et à accueillir mammifères, reptiles, oiseaux et insectes ? Andras Jambor, paysagiste et responsable du pôle maîtrise d’œuvre de l’agence TN+ a relevé le défi au sein du Village des athlètes.
Vous avez-conçu la forêt fraîche au cœur du Village des athlètes. En quoi consiste ce projet ?
Nous avons imaginé un jardin-forêt au cœur des Quinconces, un quartier d’habitation du Village des athlètes réalisé par le groupement Icade, Caisse des Dépôts et CDC Habitat. C’est rare de pouvoir imaginer un jardin de cette ampleur entouré de murs, à l’image de l’« hortus conclusus » (le jardin clos en latin) qui correspondait à l’idée que l’on se faisait du paradis au Moyen-Âge.
Ce projet reflète parfaitement le credo de TN+ : ville et nature ne sont pas antinomiques, on peut les réconcilier notamment en s’inspirant de la seconde. Dans la nature, on voit bien que la végétation s’adapte à des configurations variées. En montagne, les prairies prospèrent sur de très fines couches de terre. Sur les falaises calcaires, les plantes profitent de la moindre anfractuosité pour se développer. La ville et les immeubles, de la même manière peuvent constituer un substrat fertile pour la nature, à condition que le quartier soit pensé ainsi dès le départ. Or c’est justement la démarche que nous avons adoptée avec ce jardin-forêt.
Comment l’idée est-elle née ?
Nous sommes partis du plan initial de Dominique Perrault pour le Village des athlètes, qui imaginait des bâtiments navires en lien avec la Seine. Le jardin a été conçu comme un morceau de paysage francilien amené par une péniche, telle une arche de Noé, déposant ici son îlot refuge de biodiversité végétale et animale…
L’image est onirique, voire utopique, mais en même temps très concrète. Cela supposait de reconstituer un échantillon d’une forêt d’Île-de-France en s’inspirant de la végétation des ripisylves* boisés des côteaux de la Seine. Parmi nos inspirations, on peut évoquer une des œuvres du land-artiste américain Robert Smithson, qui avait imaginé apporter un morceau de la forêt primitive de Manhattan au cœur de la ville par bateau.
Quel type de végétation y retrouve-t-on ?

Trois univers différents coexistent : le cœur de forêt, la lisière et la prairie. Chacun apporte quelque chose de spécifique. Le cœur de forêt est un lieu de calme, de promenade, d’observation de la nature. La lisière présente un grand intérêt en termes de biodiversité. Il y a beaucoup de lumière, et elle se situe à la rencontre de deux milieux, la forêt et la prairie, ce qui attire une très grande diversité d’espèces. C’est ici que nous avons concentré des usages actifs du voisinage (barbecue, tables de piquenique, potagers, terrain de jeu). Les prairies se retrouvent tout en haut des tours et restent inaccessibles à l’homme, offrant un refuge, entre autres, aux oiseaux migrateurs qui suivent les méandres de la Seine.
D’où viennent les arbres ? S’agit-il exclusivement d’espèces propres à la région ?
Le site est relativement étroit, avec 22 mètres de large sur 160 mètres de long. Nous avons donc dû retenir des espèces de moyen développement au feuillage léger (peuplier tremble, bouleau, aulne, sorbier, merisier, érable champêtre) et quelques arbres de plus grande taille, comme les charmes, le chêne chevelu, l’érable, le tilleul.
La très grande majorité des espèces sont indigènes, et possèdent le label végétal local, qui garantit que les spécimens ont été semés, plantés et élevés dans la région, à partir des plantes mères locales. C’est un label exigeant et complet, qui préserve la biodiversité francilienne et garantit une meilleure adaptabilité des plantes aux conditions locales. Celles-ci sont riches d’un capital génétique indigène qui leur permet de mieux résister au climat, aux nuisibles, aux invasifs et insectes de la région.
Pour renforcer la résistance du cortège végétal face au changement climatique, nous avons également planté des essences venant du sud de la France, comme l’érable de Montpellier, le romarin, le lavandier et le figuier. Et nous avons remplacé le chêne sessile francilien par le chêne chevelu, davantage adapté au climat à venir, plus aride.
Et pour le sol ? d’où proviennent les terres ?
Il y a dix ans, pour donner le jour à un jardin en ville, on n’hésitait pas à prendre la terre des champs agricoles. Bien sûr, il était hors de question d’agir ainsi aujourd’hui… Nous avons donc recouru à deux stratégies différentes. D’un côté, nous avons recyclé la terre d’origine du site. Couverte de béton durant des décennies, elle était devenue inerte. Nous l’avons confiée à une entreprise spécialisée qui l’a revivifiée avec des micro-organismes, des bactéries, des champignons, en la faisant murir pendant plusieurs mois pour obtenir un substrat riche et fertile mélangé ensuite à des granulats, pour plus de porosité. Cette terre ainsi régénérée s’appelle « anthroposol ». Et d’un autre côté, nous avons regénéré des déblais inertes provenant d’autres chantiers, destinés, au départ, à la déchetterie.
Pourquoi parler de forêt fraîche ?
Le jardin draine et recycle l’ensemble des eaux de pluie qui tombent sur la parcelle et sur les toitures. Les bâtiments rejettent l’ensemble des eaux pluviales directement vers le jardin grâce à des gargouilles. Cette irrigation naturelle permet d’avoir une prairie mi sèche, mi humide selon les endroits et même une mare côté Seine surplombée par une passerelle en bois, en position de belvédère. S’ajoute à cela la strate arborée qui apporte de l’ombrage et de la fraîcheur. La présence de l’eau et de la végétation se combinent pour apporter de la fraîcheur et créer un microclimat propre au jardin. Une nouvelle de Jean Giono, « l’homme qui plantait des arbres », parle magnifiquement des liens qui s’établissent entre l’eau et la végétation pour revivifier une terre devenu aride. C’est l’histoire d’un berger des Alpes de Haute Provence qui consacre sa vie à planter des arbres dans une région pillée par les forestiers et dévastée par la sécheresse. Au bout d’un moment, à force de planter des arbres, l’eau revient dans la région.





Quel effet de rafraîchissement peut-on attendre dans les logements ?
En ville, il fait toujours quatre à cinq degrés de moins dans un parc bien ombragé, riche en différentes strates végétales. Les logements vont aussi en profiter, jusqu’à R+4. Mais à partir cinq étages, l’effet s’estompe, bien sûr…
Quel type d’animaux pourra-t-on y voir ?
La forêt, la prairie, la lisière, la mare devraient attirer naturellement une grande biodiversité. Les grenouilles, les reptiles viendront d’eux-mêmes s’installer dans la zone humide. Nous avons disposé dans toutes les strates de la végétation des abris destinés aux hérissons, aux insectes, à l’avifaune et aux chiroptères. Les terrasses inaccessibles serviront de refuge aux oiseaux migrateurs. La forêt fraîche va favoriser le développement d’un biotope à part entière, connecté aux espaces naturels voisins riches de la Seine.
Comment sera entretenu cet espace ?
L’idée principale est de laisser la nature faire son travail. Nous avons donné un coup de pouce initial, à elle de jouer maintenant. Nous sommes aux antipodes du jardin classique harmonieux, domestiqué, conçu comme un refuge face à la « sauvagerie » de la nature. Un entretien minimal est donc prévu. On laisse le cœur de la forêt tranquille, car il a vocation à devenir une « vraie » forêt. Et l’on fauche la zone de prairie deux fois par an. C’est important, car si on ne le fait pas, cet espace évoluera en forêt. Or la richesse de la biodiversité est renforcée par la diversité des milieux, forêt, lisière et prairie…
Existe-t-il des projets similaires, ou est-ce un projet véritablement unique ?
C’est très rare pour un paysagiste de pouvoir exprimer ainsi toutes les idées qui lui tiennent à cœur. C’est sans doute un peu pionnier, mais cette approche est dans l’air du temps et intéresse de plus en plus de monde. Quand j’ai débuté, le métier de paysagiste n’était guère valorisé, aujourd’hui, il est presqu’à la mode !
Parmi les inspirations, nous pouvons citer le projet de l’Île Derborence, un parc de huit hectares qui jouxte la gare TGV Lille Europe. On la doit au jardinier Gilles Clément. Dans les années 90, celui-ci a décidé de donner le jour à une forêt de 2500 m² perchée au-dessus de murs de plusieurs mètres. Contrairement à notre forêt fraîche, elle est entièrement inaccessible au public. Mais elle va dans le même sens : prouver que si on lui laisse de l’espace, le vivant peut retrouver sa place en ville.
* Association végétale spécifique que l’on retrouve aux abords des cours d’eau